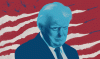Depuis des décennies, la question des dépenses de défense insuffisantes en Europe agace les responsables politiques américains. Ces critiques ont atteint leur apogée durant le premier mandat du président Donald Trump et demeurent un sujet de controverse sous son second mandat.
Lors de la première invasion russe de l'Ukraine, en 2014, seuls trois membres de l'OTAN, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Grèce, ont réussi à atteindre l'objectif de l'alliance, consistant à consacrer 2% de leur produit intérieur brut (PIB) à la défense. Plus d'une décennie plus tard, 23 membres ont désormais atteint cet objectif. C'est un progrès, mais plusieurs pays n'ont pas encore atteint ce seuil.
L'invasion russe de l'Ukraine en 2022 aurait dû servir de signal d'alarme pour l'Europe. À travers tout le continent, les dirigeants se sont engagés à renforcer leurs capacités de défense. Des promesses ont afflué pour accroître les dépenses militaires, moderniser les forces armées et fournir à l'Ukraine des stocks existants et de nouvelles armes. Certaines de ces promesses ont été tenues, d'autres ignorées ou discrètement oubliées. Certes, l'Europe est désormais mieux préparée en matière de dépenses de défense, mais le chemin reste encore long.
C'est là que l'UE tente d'intervenir. Depuis les débuts de l'intégration européenne, la défense a été un domaine difficile à atteindre. Cela est compréhensible : la décision d'envoyer les jeunes hommes et femmes d'un pays au combat est l'une des responsabilités les plus sacrées d'un gouvernement national. Elle ne devrait pas être prise par des bureaucrates distants à Bruxelles.
Avant l'arrivée au pouvoir du président Trump, les États-Unis se méfiaient des efforts de défense menés par l'UE. Washington redoutait que les modestes fonds européens alloués à la défense ne soient détournés de l'OTAN au profit de projets européens. À une époque où la majorité des membres de l'OTAN sous-investissaient dans la défense, toute duplication ou dilution des ressources était perçue comme un danger pour les capacités de l'alliance.
Les États-Unis ne voulaient pas non plus voir leur influence sur le système de sécurité européen réduite. Cela se comprend aisément, étant donné l'importance économique de l'Europe pour Washington et les contributions majeures des États-Unis à la défense du continent depuis la Seconde Guerre mondiale.
À la fin des années 1990, alors que les ambitions de l'UE en matière de défense commençaient à prendre de l'ampleur, la secrétaire d'État Madeleine Albright a défini la position américaine avec sa politique des « trois D » : aucune discrimination à l'encontre des membres de l'OTAN non membres de l'UE (qui comprenaient alors les États-Unis, le Canada, la Norvège et la Turquie, rejoints plus tard par le Royaume-Uni post-Brexit et d'autres) ; aucun découplage des garanties de sécurité américaines vis-à-vis de l'Europe ; et aucune duplication des capacités de l'OTAN.
Mais une fois Trump a repris ses fonctions, il a changé la perspective américaine. Certains de ses proches n'ont pas hésité à envisager un rôle réduit des États-Unis au sein de l'OTAN, voire leur retrait total de l'alliance. De ce fait, ils ont accueilli positivement l'idée que l'UE assume une part plus importante de la défense européenne.
L'UE devrait œuvrer pour un marché de la défense ouvert, qui maximise les capacités disponibles pour les forces armées européennes. Luke Coffey
Les partisans européens d'une plus grande intégration, à l'instar du président français Emmanuel Macron, ont saisi cette évolution pour promouvoir ce qu'il appelle « l'autonomie stratégique », c'est-à-dire l'idée que l'Europe devrait être en mesure de gérer ses propres affaires militaires sans dépendre de l'OTAN ou des États-Unis.
Bien que cette idée soit populaire à Paris et à Bruxelles, elle suscite de vives inquiétudes parmi de nombreux pays d'Europe de l'Est. Ces pays, qui vivent sous l'influence de l'agression russe, connaissent bien l'importance de la puissance militaire américaine pour préserver la paix et la stabilité. Pour eux, tout affaiblissement des liens transatlantiques pourrait être désastreux, voire une menace existentielle.
En réponse à l'agression russe, l'UE a lancé une initiative de 150 millions d'euros (164 millions de dollars) pour cofinancer les achats de défense des États membres. Cependant, un piège se cachait derrière : au moins 65% de ce financement devait être consacré à des produits fabriqués au sein de l'UE. Autrement dit, cette politique désavantage explicitement les membres de l'OTAN qui ne font pas partie de l'UE, exactement ce contre quoi Madeleine Albright avait mis en garde il y a 25 ans.
Il est facile de comprendre pourquoi certains pays pourraient vouloir privilégier leurs industries de défense nationales. En période de crise, il est rassurant de savoir que des capacités militaires essentielles seront disponibles sans avoir à dépendre de fournisseurs étrangers, même alliés. Cette logique a été renforcée par les menaces de l'ère Trump, qui envisageait de retirer le soutien militaire à ses alliés, ainsi que par les restrictions sélectives imposées par l'administration Obama sur les ventes d'armes aux principaux alliés des États-Unis.
Mais la politique de défense ne peut se résumer à une simple tâche. Certes, les pays voudront maintenir certaines capacités stratégiques sur leur sol, mais dans un monde fondé sur les alliances et l'interdépendance, il est logique de partager les responsabilités. Les gouvernements devraient privilégier l'acquisition des meilleurs équipements militaires au meilleur prix, sans jamais compromettre la sécurité.
Toutefois, fixer à 65% l'exigence de dépenses de défense pour l'UE est contre-productif. Elle exclut certains des plus grands producteurs mondiaux de défense : les États-Unis, le Royaume-Uni et la Turquie. Ces trois pays disposent de systèmes éprouvés et de haute qualité, allant des plateformes de défense aérienne américaines et britanniques aux drones turcs de pointe. Ces capacités pourraient considérablement améliorer la politique de défense de l'Europe, notamment face aux menaces russes et à l'instabilité dans son voisinage. Si l'UE veut vraiment être prise au sérieux en matière de défense, elle doit œuvrer pour un marché de la défense ouvert et concurrentiel, qui maximise les capacités des forces armées européennes plutôt que de les limiter au nom de la politique industrielle.
Malheureusement, un changement semble loin d'être envisageable. La récente escalade de la guerre commerciale mondiale sous l'impulsion de Trump, notamment l'imposition de nouveaux droits de douane sur les produits européens, ne fera que renforcer les tendances protectionnistes à Bruxelles. Toutefois, le prix de ces choix pourrait être élevé. En effet, 23 des 27 membres de l'UE sont aussi membres de l'OTAN. Si Bruxelles restreint leur capacité à acquérir le meilleur équipement, quel que soit son lieu de production, cela pourrait affaiblir non seulement la position de défense de l'UE, mais également celle de l'OTAN.
À l'heure où l'avenir de l'Ukraine est en jeu et où l'engagement de la Maison Blanche envers l'OTAN est remis en question, l'Europe ne peut se permettre de laisser l'idéologie ou la politique industrielle entraver sa préparation militaire. Le continent doit désormais adopter une approche pragmatique, ce qui se traduira par l’achat du meilleur équipement disponible, qu'il soit fabriqué en France, au Royaume-Uni, en Turquie ou aux États-Unis. Une telle mesure mettrait en péril non seulement la capacité de l'Europe à se défendre, mais favoriserait également ceux qui cherchent à affaiblir l'alliance transatlantique.
Luke Coffey est chercheur associé à l'Institut Hudson.
X: @LukeDCoffey
NDLR: L’opinion exprimée dans cette page est propre à l’auteur et ne reflète pas nécessairement celle d’Arab News en français.
Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com