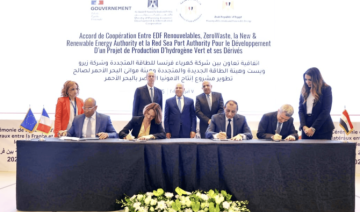PARIS : A quelques jours des vacances de Noël, le gouvernement doit dévoiler une réforme des retraites très contestée, que ses opposants se préparent à bloquer par tous les moyens, de la rue au Parlement.
Le cadeau ne fera pas beaucoup d'heureux. Après une courte concertation, Elisabeth Borne va enfin présenter --probablement jeudi après-midi-- les grandes lignes de la réforme des retraites, pierre angulaire du second quinquennat d'Emmanuel Macron.
L'exécutif a déjà commencé à préparer les esprits, multipliant les entretiens à la presse, les réunions de travail à Matignon et les dîners au sommet à l'Elysée. Mais les annonces de la Première ministre sont courues d'avance, balisées par la promesse présidentielle de repousser l'âge légal de 62 à 64 voire 65 ans. Cette dernière borne tient la corde.
"C'est le seul levier que nous avons", affirme le chef de l'Etat, qui exclut depuis le départ d'augmenter les cotisations ou de réduire les pensions. Cette mesure, assortie ou non d'une hausse de la durée de cotisation, risque de reléguer au second plan d'éventuelles contreparties sur la pénibilité ou les petites pensions.
D'autant que le gouvernement veut aller vite: un projet de loi en janvier, un vote au printemps, une entrée en vigueur à l'été, avec la "génération 1961" pour essuyer les plâtres. Comme une urgence, justifiée par le retour durable de déficits massifs, qui dépasseraient 12 milliards en 2027.
Impossible pour M. Macron de laisser un tel héritage à son successeur, surtout après l'échec de son projet de "système universel de retraite", stoppé net par le Covid. Le temps lui est donc compté, avant les élections européennes de 2024 qui sonneront la mi-temps de son mandat.
Réformer les retraites, le projet au long cours d'Emmanuel Macron
La réforme des retraites est un projet au long cours d'Emmanuel Macron, entamé durant son premier quinquennat au prix d'une forte opposition puis suspendu en raison du Covid et remis en chantier sous une forme remaniée.
Système par points
Annoncée par Emmanuel Macron lors de sa campagne présidentielle de 2017, une première tentative de réforme vise à remplacer les 42 régimes existants (privés, spéciaux, des fonctionnaires etc) pour créer un système de retraite universel par points.
En 2019, anticipant un déficit futur, l'exécutif prévient qu'il faudra allonger la durée du travail.
Jean-Paul Delevoye, nommé haut-commissaire à la réforme des retraites, consulte syndicats et patronat et préconise un "âge d'équilibre" à 64 ans pour une retraite à taux plein.
Grèves et âge pivot
L'inquiétude monte dans certaines branches: le 13 septembre 2019 grève à la RATP puis, en décembre, deux journées nationales d'action très suivies.
La grève devient reconductible à la SNCF et la RATP et atteint des taux records chez les enseignants.
Le 11 décembre, le Premier ministre Edouard Philippe présente son projet: le système universel par points s'appliquera à partir de la génération 1975, voire celles de 1980 ou 1985 pour certains fonctionnaires et agents de régimes spéciaux.
Un système de bonus-malus incitera à travailler plus longtemps avec un "âge d'équilibre" fixé à 64 ans en 2027. Cet "âge pivot" fait basculer la CFDT dans le camp des opposants.
Recours au «49-3»
Une troisième journée nationale d'action est organisée le 17 décembre à l'appel de l'ensemble des syndicats et les transports sont perturbés pendant les congés de fin d'année.
Des concessions sont accordées à une dizaine de professions (policiers, pilotes de ligne, marins, danseurs de l'Opéra...)
Le 11 janvier 2020, Edouard Philippe se déclare "disposé à retirer", sous conditions, l'âge pivot de 64 ans.
La mobilisation se poursuit dans les ports, raffineries, à la Banque de France, à l'Opéra de Paris, chez les avocats.
La grève illimitée est suspendue à partir du 20 janvier à la RATP. Le trafic redevient normal à la SNCF.
Le projet de loi fait l'objet de 41 000 amendements. Le gouvernement engage la procédure de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution: le texte est adopté en première lecture dans la nuit du 3 au 4 mars.
Suspension en raison du Covid
Le 16 mars 2020, Emmanuel Macron annonce la suspension de "toutes les réformes en cours" dont celle "des retraites", en raison de la pandémie de Covid-19.
Le 2 juillet, il dit qu'il n'y aura pas d'abandon de la réforme mais une "transformation" après concertation.
Le 13 juillet 2021, il assure que la réforme sera engagée "dès que les conditions sanitaires seront réunies". En novembre, il repousse la réforme à 2022.
Age légal à 65 ans
Fin 2021, Emmanuel Macron réitère sa volonté de réformer les retraites, mais évoque "un système simplifié avec trois grands régimes, un pour la fonction publique, un pour les salariés, un pour les indépendants".
Réélu en 2022 après s'être engagé durant la campagne à "décaler l'âge de départ légal (de départ à la retraite, ndlr) jusqu'à 65 ans" contre 62 actuellement, il appelle le 14 juillet à "des compromis responsables" en vue d'une entrée en vigueur de la réforme à l'été 2023.
Concertations
Face à l'opposition virulente des syndicats devant un possible passage en force parlementaire, Emmanuel Macron demande le 22 septembre au gouvernement de "trouver la bonne manoeuvre" pour une réforme "apaisée".
Début octobre, la Première ministre Elisabeth Borne engage la concertation avec les partenaires sociaux pour, espère-t-elle, une adoption "avant la fin de l'hiver".
Le 26 octobre, le président se dit "ouvert" à un âge légal de départ à 64 ans, au lieu de 65 ans.
Mais il insiste le 3 décembre: "travailler plus longtemps" est "le seul levier" pour faire face aux "besoins de financement massifs".
Malgré la menace d'une mobilisation syndicale dès janvier 2023, l'exécutif maintient son projet qui devrait être dévoilé autour du 15 décembre.
Tenté de passer en force au début de l'automne via le budget de la Sécu, il s'est résolu à patienter trois mois de plus. A peine assez pour consulter les partenaires sociaux, jouer l'ouverture et constater les désaccords de fond.
«Ils sont obstinés»
Car aucun syndicat n'accepte cette réforme, pas même la CFDT qui a durci sa position sur le sujet lors de son dernier congrès en juin. Depuis, son leader Laurent Berger martèle son opposition à toute "mesure d'âge" et met en garde contre une "réforme dure" qui provoquerait une "réaction sociale tout aussi déterminée".
Son homologue de la CGT, Philippe Martinez, enjoint aussi l'exécutif à "prendre ça au sérieux", mais sans se faire d'illusion: "Ils sont obstinés". Ses troupes savent aussi se montrer coriaces, comme l'ont rappelé les récents blocages de raffineries.
Sur fond d'inflation record et de revendications salariales, les coups de semonce ont également touché les industries électriques et gazières, ainsi que la RATP, dont les régimes spéciaux sont dans le collimateur du gouvernement.
De simples avertissements, qui réveillent le spectre du long conflit social de l'hiver 2019-2020, auquel s'étaient ralliés cheminots, routiers et dockers, entre autres. Mais les stratèges syndicaux attendent le bon moment pour en découdre.
Depuis 30 ans une série de grandes réformes des retraites
La France a connu depuis une trentaine d'années une série de grandes réformes de ses systèmes de retraite pour répondre au vieillissement de la population et à la dégradation financière de ses caisses.
Un projet de réforme voulu par Emmanuel Macron depuis son premier quinquennat, visant à l'origine à unifier les régimes et instaurer un système par points, a été suspendu en mars 2020 en raison de la crise sanitaire. Il a été remis en chantier sous une forme remaniée en 2022, prévoyant notamment de retarder l'âge légal de départ à la retraite.
Rappel des principales réformes qui ont précédé:
1991: Livre blanc
La publication en 1991 du Livre blanc sur les retraites marque un tournant: il met en évidence les difficultés financières à venir des régimes et préconise d'allonger la durée de cotisation de 150 à 168 trimestres pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Les réformes qui suivront viseront à réduire les déficits des caisses ou à revoir leurs modalités de financement.
1993: réforme Balladur
En 1993, sous la présidence de François Mitterrand, le Premier ministre de cohabitation Edouard Balladur décide de porter progressivement de 37,5 ans à 40 ans (de 150 à 165 trimestres) la durée de cotisation dans le privé pour une retraite à taux plein.
Le montant des retraites est désormais calculé sur les 25 meilleures années de la vie active au lieu des 10 meilleures. Mise en oeuvre au coeur de l'été, la réforme provoque peu de remous.
1995: plan Juppé
En novembre 1995, sous la présidence de Jacques Chirac, le Premier ministre Alain Juppé présente un plan de redressement de la Sécurité sociale comportant une réforme des retraites des agents de l'État et des services publics.
Les fonctionnaires observent plusieurs semaines de grève. Trains et métros sont paralysés pendant plus de trois semaines. Alain Juppé renonce aux mesures sur les retraites mais maintient le reste de son plan.
2003: réforme Fillon
La réforme de François Fillon, ministre des Affaires sociales du gouvernement Raffarin, complète celle de Balladur, portant la durée de cotisation à 40 ans pour les fonctionnaires.
Elle fixe les règles d'allongement futur des durées de cotisation pour le privé et la fonction publique, incite à rester dans l'emploi après 60 ans, créant une surcote et limitant l'accès aux pré-retraites.
Négociée avec les syndicats, la réforme provoque grèves et manifestations. Elle n'est acceptée que par la CFDT.
2007: régimes spéciaux
La première réforme des retraites du quinquennat de Nicolas Sarkozy concerne les régimes spécifiques des sociétés de service public (EDF, GDF, SNCF, RATP, Banque de France, etc.) ainsi que les professions à statut particulier (clercs de notaires, élus et employés parlementaires).
Pour ces salariés, la durée de cotisation passe à 40 ans. La réforme est menée avec diplomatie pour ne pas répéter l'échec de 1995.
2010: réforme Woerth
Du nom d'Éric Woerth, ministre du Travail, cette réforme met fin au principe de la retraite à 60 ans, héritage de François Mitterrand. Très impopulaire, la seconde réforme des retraites de la présidence Sarkozy provoque manifestations massives et blocages.
L'âge légal de départ est reculé de deux ans, passant progressivement à 62 ans. Il en va de même pour l'âge du départ à taux plein (67 ans en 2022).
La réforme étend le dispositif carrières longues à ceux qui ont commencé à travailler à 17 ans, permettant des départs anticipés.
2014: réforme Touraine
Portée par la ministre des Affaires sociales Marisol Touraine, sous la présidence de François Hollande, cette réforme inscrit dans le temps le principe de l'allongement de la durée de cotisation pour l'obtention d'une retraite à taux plein.
Cette durée est relevée d'un trimestre tous les trois ans de 2020 à 2035 pour atteindre 172 trimestres (43 ans) pour les générations 1973 et suivantes.
Un compte personnel de pénibilité est instauré pour permettre à ceux qui exercent des métiers difficiles d'anticiper leur départ.
Retraites: «le jeu n'est pas fait» sur l'âge légal à 65 ans, assure Braun-Pivet
La présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a assuré dimanche que "le jeu n'est pas fait" sur un âge légal de la retraite à 65 ans, alors qu'Elisabeth Borne doit présenter son projet de réforme jeudi et le Parlement s'en emparer début 2023.
65 ans, comme l'avait annoncé Emmanuel Macron, ou 64 ans? "Cela pourra, je pense, bouger si l'Assemblée veut aller dans ce sens-là et que le gouvernement y est prêt", a déclaré la députée Renaissance à France Inter-franceinfo-Le Monde.
"Je suis tout à fait ouverte à des +bougés+, pour autant que les objectifs de la réforme puissent être atteints, c'est-à-dire un équilibre financier et de la justice sociale", a-t-elle ajouté, en insistant: "le jeu n'est pas fait".
Emmanuel Macron avait défendu pendant la campagne présidentielle un report de l'âge légal de 62 à 65 ans, avant d'évoquer une fois réélu un recul à 64 ans couplé à une augmentation de la durée de cotisation. Le report à 65 ans est désormais la piste privilégiée, selon des responsables de la majorité qui ont participé mercredi soir à un dîner à l'Elysée. Mme Braun-Pivet n'y a pas participé car elle fêtait son anniversaire en famille.
"On a fait campagne pendant des semaines autour de l'âge de 65 ans, donc il ne serait pas étonnant qu'on rentre dans la mêlée avec un âge de 65 ans donc", a convenu le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, dimanche auprès de RTL-Le Figaro-LCI. Mais "nous sommes dans la concertation permanente", a-t-il précisé.
La Première ministre doit recevoir jusqu'en milieu de semaine prochaine les patrons des groupes parlementaires, avant de présenter les contours du projet de réforme jeudi, date confirmée par M. Véran.
Si aucune majorité ne se dégage début 2023 à l'Assemblée nationale en faveur de la réforme, le gouvernement pourra toujours recourir à l'arme constitutionnelle du 49.3 pour la faire passer sans vote.
Mme Braun-Pivet s'est dite "convaincue qu'il y a un chemin, mais le chemin n'est pas trouvé à l'avance" pour éviter ce recours au 49.3 et parvenir à "une réforme consensuelle": "c'est à ça que servent la concertation et le débat parlementaire".
"L'Assemblée nationale est à même d'être le lieu par excellence du débat démocratique", qui est "de nature à apaiser le climat social", veut-elle croire.
Les secrétaires généraux de la CFDT et de la CGT, Laurent Berger et Philippe Martinez, ont déjà promis une mobilisation sociale "déterminée" en cas de report de l'âge de départ.
Les huit centrales nationales (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires et FSU) ont prévu de se réunir dans la foulée des annonces de Mme Borne, pour caler leur riposte autour de la date de présentation du projet de loi en Conseil des ministres - peut-être le 11 janvier.
La suite se jouera autant dans la rue qu'à l'Assemblée, où le texte est promis à un chemin de croix. La cheffe des députés LFI, Mathilde Panot, jure de le "combattre pied à pied" avec une pluie d'amendements. A l'autre extrémité de l'hémicycle, Marine Le Pen a fait connaître son "opposition absolument totale sur le fond" de la réforme.
Les chefs des différents groupes parlementaires seront à nouveau reçus à Matignon entre lundi et jeudi matin. Mais à moins d'une improbable alliance avec Les Républicains, le recours au 49.3 semble inéluctable. Une option que la majorité soutient d'avance, à l'instar de la patronne des députés Renaissance, Aurore Bergé, qui juge que ce scénario "ne doit pas être tabou".