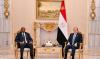La Tunisie vient de connaître son troisième gouvernement en une seule année : l'équipe de Hichem Mechichi a en effet passé le cap du Parlement, malgré les profondes et constantes dissensions qui l'ont souvent paralysé.
Bien que le gouvernement, agréé par la haute chambre représentative, soit composé essentiellement de technocrates non affiliés à des partis, il s'est imposé aux différents acteurs politiques comme seule alternative viable après les échecs précédents de coalitions majoritaires issues des partis représentés au sein de l'Assemblée parlementaire.
Ce fait ne peut constituer la preuve d'une dynamique démocratique vigoureuse qui incarne l'exception tunisienne dans le processus des transitions politiques arabes. Nous serons plutôt enclins à le considérer comme le symptôme alarmant d'un dysfonctionnement grave du système politique institué après la chute du régime de Ben Ali.
La Tunisie a choisi, à l'issue d'une longue et inclusive concertation nationale, un système parlementaire considéré comme plus susceptible de garantir les libertés politiques et l'équilibre des pouvoirs, et de prémunir ainsi le pays du spectre du despotisme monolithique.
Tout en concédant que le régime des libertés s'est amélioré de façon substantielle après la révolution du Jasmin, et que des « compétitions » électorales ont été régulièrement organisées, nous ne considérons pourtant pas que la démocratie tunisienne balbutiante a réussi ses ambitions réformatrices.
Cependant, force est de constater que ce modèle, souvent vanté comme une exception heureuse, a conduit au blocage permanent des institutions politiques.
Si l’ethos démocratique répondait – selon l'assertion communément admise – à la double finalité de renforcer le socle institutionnel de l'État et de résoudre la problématique de légitimité politique du pouvoir constitué, le modèle tunisien serait loin d'être une réussite enviée.
Tout en concédant que le régime des libertés s'est amélioré de façon substantielle après la révolution du Jasmin, et que des « compétitions » électorales ont été régulièrement organisées, nous ne considérons pourtant pas que la démocratie tunisienne balbutiante a réussi ses ambitions réformatrices.
Un climat de « déception » est perceptible actuellement dans la rue, une nostalgie obsessionnelle du régime despotique déchu est même visible, face à une crise multiforme qui secoue âprement la société tunisienne désabusée.
Dans un contexte différent, le philosophe français Jacques Derrida a souligné un jour « le penchant suicidaire des démocraties ». Cette formule nous semble appropriée pour décrire la situation politique tunisienne, où les mécanismes procéduraux de représentation et de gouvernance n'ont nullement conduit à apaiser le champ politique ni à frayer le chemin à une véritable alternative de changement social.
Le débat politique s'est enkysté dans des querelles stériles sur les enjeux de gestion de l'espace public réduit au champ de privilèges et de manipulation clientéliste. Quitte à pousser les acteurs politiques à nouer des alliances circonstancielles contre nature. Le principe de différenciation – entre l'État comme substance éthique, entité institutionnelle, et l'autorité politique changeante mandatée pour la gouvernance administrative – faisant défaut dans ce schéma mimétique de la démocratie pluraliste, on ne peut donc parler d'une véritable dynamique démocratique en Tunisie.
Le modèle tunisien a été pris en tenailles entre le mouvement Ennahdha, qui fut, à l'heure fatidique du changement, la seule force organisée capable de mobilisation électorale (sur la base de prédication religieuse non assumée), et les forces populistes qui ont fini par propulser à la présidence l'actuel chef de l’État aux pouvoirs constitutionnels limités qui contrastent avec ses grandes ambitions de remodelage global du système politique.
Bien que les dernières élections législatives (octobre 2019) aient acté la défaite relative du mouvement Ennahdha, en perte de vitesse continue, le parti islamiste reste néanmoins la force principale sur l'échiquier politique, en alliance solide avec d'autres mouvements radicaux (comme la coalition Al Karama de Seif Eddine Makhlouf) et en alliance stratégique avec les partis considérés comme les parias de la vie politique tunisienne (par exemple le parti Qalb Tounes, boudé par les partis libéraux).
La Tunisie a une vieille tradition libérale, remontant au réformisme de Khair Eddine Pacha qui a institué la première constitution démocratique arabe (en 1861) et introduit un enseignement moderne et moderniste. L’expérience bourguibiste est le fruit de cette tradition : elle a marqué la société tunisienne dans les domaines sensibles du droit des femmes, de l’ingénierie institutionnelle, et de l’économie solidaire.
Ce legs libéral n'a pas été investi par une force politique consistante, d'où la pertinence de la question, jadis posée par Ghassan Salamé, concernant le potentiel du libéralisme arabe : la démocratie peut-elle prendre corps et s'enraciner sans démocrates qui la revendiquent et la défendent ?
Sans nier la persistance et la profondeur de la demande démocratique en Tunisie, nous pouvons cependant mettre en évidence le décalage notoire entre cette demande et l'état actuel de la démocratie tunisienne.
Seyid Ould Bah est professeur de philosophie et sciences sociales à l'université de Nouakchott,Mauritanie et chroniqueur dans plusieurs médias. Il est l'auteur de plusieurs livres en philosophie et pensée politique et stratégique.
Twitter: @seyidbah
NDLR : L’opinion exprimée dans cette page est propre à l’auteur et ne reflète pas nécessairement celle d’Arab News en français.