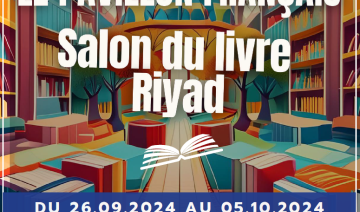TRIBUNAL DE PARIS : Quatorze personnes, dont trois en fuite, suspectées d’avoir apporté leur aide aux terroristes des attentats de janvier 2015, sont jugées depuis trois semaines par une cour d’assises spéciale du tribunal de Paris.
Les audiences du 14 septembre sont consacrées à l’attaque brutale, d’une violence inouïe, perpétrée par les frères Kouachi, le 7 janvier 2015, dans les locaux de Charlie Hebdo, et plus précisément à l’assassinat du policier Ahmed Merabet.
Me Richard Malka, avocat de Charlie Hebdo, a fait une déclaration publique, dès l’ouverture de l’audience, au sujet des nouvelles menaces d’Al Qaïda contre le journal satirique. Il précise que ces menaces ne visent pas seulement les médias, les personnes juives ou musulmanes. «66 millions de Français sont menacés», insiste-t-il.
La Cour a entendu les témoignages des membres de la famille et des anciens collègues d’Ahmed Merabet. L’ambiance est particulièrement poignante lorsque les membres de la famille du policier tué sont appelés à la barre. Une des sœurs qualifie cette tragédie de «plaie ouverte».
«Cinq ans après, la douleur est toujours présente. […] J’attends que justice soit faite, j’ai confiance en la justice des hommes», déclare-t-elle à la barre.
«Comment voyez-vous votre futur sans Ahmed ?», lui demande son avocat, et la sœur du policier répond : «J’ai du mal, on vit au jour le jour, il me manque énormément […]. Cette tragédie a brisé ma famille, nous avons une plaie ouverte qui ne se refermera jamais. Maman est éteinte, elle n’a plus goût à rien, elle s’inquiète en permanence», témoigne-t-elle, submergée par l’émotion.
Un sentiment de culpabilité
Lors des audiences, ceux qu’on les appelle les « primo intervenants » gardent des séquelles psychiques quasi permanentes, des flashs de ces scènes traumatiques qui ne quittent pas leurs pensées et perturbent leur vie personnelle et professionnelle à jamais.
À l’époque gardiens de la paix ou adjoints de sécurité, agents débutants ou expérimentés, tous évoquent le caractère macabre de cette matinée du 7 janvier 2015 et relatent leur effroi au moment de la découverte du massacre. « C’est une scène de guerre », répètent-ils au fil des passages.
À la barre, ses anciens collègues décrivent Ahmed Merabet comme un homme « discret, droit, sur qui on peut compter ». Un autre précise : « Dès qu’on demandait du renfort, il était disponible pour épauler ses collègues ; au travail, il était très professionnel. »
D’autres policiers de la BAC du XIe arrondissement de Paris ont exprimé, quant à eux, leurs regrets de n’avoir pas pu faire plus pour éviter le massacre ; un sentiment de culpabilité qui les poursuivra à jamais. Les témoignages des policiers se succèdent et révèlent les mêmes séquelles : insomnies, crises d’angoisse, hypervigilance, sentiment d’invincibilité, et de lourds regrets. « J’étais persuadée que si j’en avais tué un, ou simplement maîtrisé un, peut-être qu’Ahmed serait vivant, explique Élodie, policière de la BAC du XIe arrondissement, très émue, lors de son témoignage à la barre. Je vis encore avec les regrets », affirme-t-elle.
Un sentiment partagé par son chef de bord Jean-Sébastien qui, lors de son témoignage affirme : « J’ai un regret : je suis vraiment désolé pour la famille d’Ahmed de ne pas avoir pu faire plus. On a fait ce que l’on pouvait, mais peut-être aurait-on pu arriver plus tôt. Ces regrets, je les aurai toujours », explique le chef de bord, à la barre.
L’assassinat de l’un des leurs est effroyable, soudain, rapide. Ils ont été appelés en raison de suspicions de tirs. Ils arrivent rue Nicolas-Appert, et ne comprennent pas de ce qui s’y passe : « Pour moi, rue Nicolas-Appert, il n’y a pas de banque, pas de bijouterie, il n’y a rien », note G., gardienne de la paix, arrivée en VTT avec sa brigade sur les lieux. « Il ne se passe rien dans cette rue, confirme son chef de bord, on est étonné du genre d’appel qu’on a reçu. On ne voit personne ; au bout de la rue, on voit un homme qui décharge quelque chose d’un camion. »
Charlie Hebdo, la cible des terroristes
Personne ne savait que la cible était le journal satirique Charlie Hebdo, dont les locaux se situent à proximité, dans une rue qui longe le boulevard Richard-Lenoir. G. se retrouve, plus tard, face aux terroristes lorsqu’ils sortent des locaux. « Je vois deux hommes armés, cagoulés, qui tirent sur nous. Ce sont des tirs précis, coup par coup. Mon collègue n’avance pas, il est tétanisé », précise-t-elle lors de son audition. J’entends mon autre collègue qui dit : “Cours, cours !” Je cours et j’entends le “poum, poum” des balles », déclare-t-elle à la barre.
En effet, ce n’est qu’après une forte détonation que les primo intervenants comprennent qu’il se passe quelque chose de grave. Les scènes de chaos s’enchaînent, les équipements radio de la police sont saturées, les messages entre équipes ne passent pas. Les balles pleuvent, les policiers tentent de les éviter, les frères Kouachi sortent du bâtiment et les tirs se succèdent, semant la panique dans tout le quartier.
« Avec Ahmed, on s’est mis a couvert à côté d’un buisson du terre-plein central. Ahmed s’est levé, j’ai entendu une nouvelle détonation, et je suis resté à couvert », raconte Vincent, adjoint de la sécurité au moment des faits – une jeune recrue.
Ahmed Merabet est touché à la jambe, les frères Kouachi s’approchent, visent sa tête et tirent à bout portant. Après la fuite des djihadistes, Vincent est le premier à rejoindre son collègue. « J’ai vu Ahmed dans une mare de sang […]. J’ai regardé son visage. » Étranglé par l’émotion, le collègue poursuit : « J’ai demandé à Ahmed : “Est-ce que tu m’entends ?” […]. J’étais perdu », explique-t-il à la barre.
Cette scène insoutenable, largement diffusée sur les réseaux sociaux, hante toujours les proches d’Ahmed Merabet. « En quelques secondes, ma vie s’est effondrée. J’aurais voulu ne jamais voir cette vidéo qui ne s’effacera jamais de ma mémoire », témoigne l’une des sœurs d’Ahmed Merabet à la barre.
À la fin de l’audience, à la demande du président de la Cour, les accusés ont pris la parole. Abdelaziz Abbad, détenu depuis le 28 avril 2017, exprime sa compassion et souhaite « beaucoup de courage à la famille du policier abattu », et espère qu’ils auront des réponses. Miguel Martinez, lui, présente ses condoléances à la famille Merabet, et fait part du courage des policiers face aux assassins, les frères Kouachi. Saïd Makhlouf, détenu depuis le 13 mars 2015, affirme, en faisant référence aux auteurs des actes terroristes : « Ils se disent musulmans, et ils tuent des musulmans. »
Les parties civiles, quant à elles, espèrent que la justice sera rendue, même si cela ne pourra jamais faire oublier l’exécution brutale des proches, ni les traumatismes et les bouleversements qu’elle a provoqués. Chacune d’elles regrette de ne pouvoir expliquer ou comprendre ces actes abjects qui ont détruit tant de vies.