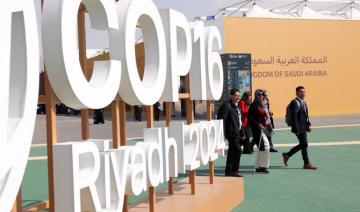Sa plume est authentique, libre et fluide. Mahi Binebine a su tirer profit du confinement pour boucler son nouveau roman en tout juste trois mois. Un roman sur le « double je » dans lequel l’enfant de l’ancienne médina de Marrakech revient aux sources. L’auteur a trouvé le temps d’écrire alors qu’il a tout juste été désigné, en juin, lauréat du Prix méditerranéen 2020 pour son roman Rue du Pardon. Prix organisé par la ville de Perpignan qu’il a refusé de venir chercher, depuis que la ville est tombée entre les mains du Rassemblement national. Rencontre avec une belle âme engagée et enragée.
Comment avez-vous vécu le confinement ?
Cette période a été pour moi un moment de détente… J’ai beaucoup travaillé et j’ai aussi pu profiter de ma famille, de mes filles… Ce confinement a été positif à 200 % ! Je me suis occupé de moi, j’ai fait du sport, perdu du poids tout en préparant ma prochaine exposition et j’ai fini mon dernier roman.
Rue du Pardon est au plus fort des ventes et vous êtes déjà sur le roman suivant !
Oui ! J’avais écrit quinze pages au début du confinement et l’isolement a été le bienvenu. Je me suis complètement plongé dans le projet. En trois mois, en travaillant dix heures par jour, j’ai tout bouclé. Mon éditrice est ravie ! Elle me conseille même un confinement à vie ! [rires]. Généralement, je mets un an pour écrire un texte, il faut ensuite compter six mois de correction par l’éditeur puis quelques mois pour la sortie. Cette fois, c’est différent. Et j’avoue que je suis plutôt satisfait du résultat.
Généralement, vos textes sont très personnels ou abordent des sujets graves, qui vous ont affecté. Comment s’est imposé celui-là ?
Pour ce roman, c’est particulier. On m’a sollicité pour écrire une nouvelle de quinze pages sur Marrakech dans le cadre d’une initiative de Yassin Adnane, qui a recueilli des textes de plusieurs écrivains dans une œuvre intitulée Marrakech Noir. La ville ocre est la première ville d’Afrique du Nord à participer à la collection noire de l’éditeur new-yorkais Akashic Books. Cela a été le déclic.
Ce nouveau roman est-il une version longue de la nouvelle ?
Oui ! À vrai dire, je me suis senti frustré. Moi qui ai l’habitude d’écrire deux cents pages, d’approfondir l’histoire, de m’attacher aux personnages, j’ai dû m’arrêter au bout de quinze pages. J’ai donc décidé d’enrichir cette nouvelle, de la transformer en roman. Et je ne suis pas le seul, d’autres auteurs qui ont participé à l’aventure ont fait la même chose.
Que raconte ce nouveau roman ?
C’est l’histoire de deux personnes qui habitent dans un même corps et qui ne sont d’accord sur rien. C’est un peu ma vie, j’ai toujours l’impression de me battre avec moi-même à chaque prise de décision. Je me bats constamment avec deux « moi ». Pour l’instant, il a pour titre Pas de deux, comme le pas de danse. Un titre à double sens. C’est un scoop ! À moins que l’éditeur ne décide de changer le titre…
Est-ce une référence à vos deux vies : celle du peintre et de l’écrivain ?
[Rires]. Peut-être. Mais je ne pense pas. Je me suis concentré sur une partie de ma vie que je n’ai jamais racontée. J’ai grandi au fin fond de la médina de Marrakech, j’étais à l’école des Sœurs. Je n’ai jamais raconté ce monde-là, où règnent le calme et la sérénité. Un décalage complet avec le chaos de la médina. J’ai vécu entre les deux mondes, comme ce texte qui est entre les deux univers, deux personnages qui ne s’entendent pas et qui, habitant le même corps, doivent cohabiter.
Vous venez de décliner le prix de la Méditerranée, décerné à votre roman Rue du Pardon… Pour quelle raison ?
Je ne me voyais pas serrer la main du nouveau maire de Perpignan, Louis Alliot, et recevoir un chèque de sa part. Ex-compagnon de Marine Le Pen, il représente le parti du Rassemblement national et prône l’exclusion. Mes confrères étaient d’accord avec moi. Je suis parti de Paris sur un coup de tête en 2002 parce que Jean Marie Le Pen était arrivé au deuxième tour des élections cette année-là. Comment se pouvait-il que, dans le pays des droits de l’Homme, il se passe une chose pareille ? J’ai quitté la France, le pays où je vivais, immédiatement, en quelques jours…
Je voyais le Maroc et ses belles promesses, Mohammed VI qui donnait des signes d’ouverture sérieux, avec les opposants qui rentraient chez eux. Ne pas aller à Perpignan est une décision logique pour moi, je ne pouvais pas renier ce pourquoi je me suis battu toute ma vie…
Ce que vous racontez très bien dans votre roman Le Fou du roi… Où en est son adaptation au cinéma ?
Nous organisons des réunions toutes les semaines avec la réalisatrice Marcela Said, mon amie depuis vingt-cinq ans. Nous avons toujours voulu travailler ensemble, et c’est un vrai bonheur de pouvoir enfin le faire. Le scénariste de talent Jamel Belmahi, qui nous a rejoints, a déjà travaillé sur Les Chevaux de Dieu. Il existe entre nous une bonne synergie et une bonne entente, je suis ravi ! Nous travaillons très bien ensemble. Avec le roman, on a toute la liberté du monde ; au cinéma, c’est différent. Il y a des contraintes budgétaires, physiques, de temps. Je suis d’autant plus content que le film va ressembler au roman, car le roman est cinématographique…