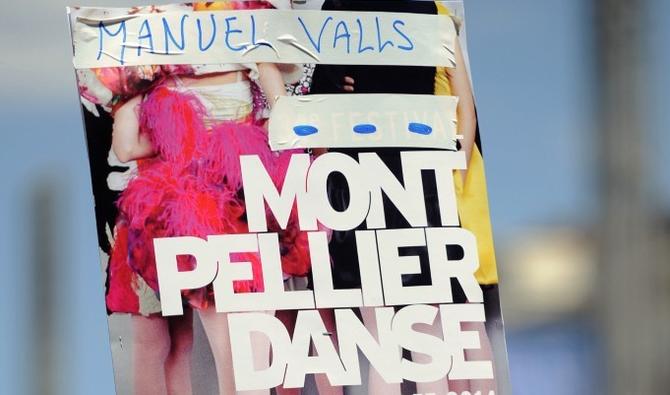MONTPELLIER: Ils se sont juré qu'ils la danseraient "toute leur vie". La pièce chorégraphique "A bras-le-corps", créée il y a trente ans et présentée au 43e festival international Montpellier Danse, dans le sud de la France, a traversé les années d'une solide amitié entre les danseurs Boris Charmatz et Dimitri Chamblas.
"C'est parce que nous sommes amis que nous avons eu envie de créer ensemble. Mais c'est parce que nous avons choisi de ne pas arrêter cette pièce que notre amitié s'est renforcée", racontent à l'AFP les deux artistes français de renom, dans les coulisses du festival.
Sur la scène surplombée d'un rectangle de néons, deux corps robustes, vêtus de blanc, s'imbriquent, s'entrechoquent, se suivent, se séparent, puis se retrouvent dans un tempo soutenu, entrecoupé de solos. "A bras-le-corps" est devenue en trois décennies un défi, physique à l'épreuve du temps qui s'abat sur un corps de danseur, et amical face aux épreuves de la vie.
Dimitri Chamblas et Boris Charmatz se sont rencontrés sur les bancs de l'école du ballet de l'Opéra de Paris, à 10 et 12 ans. Puis, lorsqu'ils se sont retrouvés, presque adultes, au Conservatoire national supérieur de Lyon, autre grande école française, leur envie de travailler ensemble a d'abord donné naissance à un film puis à ce duo, créé en 1993.
Dès la première représentation, "nous nous étions engagés à vieillir dans cette chorégraphie", à "la danser toute +notre+ vie", ou "au moins jusqu'à 65 ans", se souviennent ceux qui ont cheminé vers diverses expériences professionnelles, à Los Angeles pour Dimitri Chamblas et, depuis récemment, à la direction du célèbre Tanztheater Wuppertal Pina Bausch pour Boris Charmatz.
De la partition écrite en 1993, ils ont "tout gardé". Pas un seul changement n'a été apporté malgré les risques encourus par des chutes impulsives, des jetés et des portés musclés, imaginés fougueusement lorsqu'ils avaient 17 et 19 ans, alors que leur corps était très entrainé et malléable.
«On y croit encore»
Lorsqu'une représentation approche, la ritournelle amicale revient. Dans un studio, les deux amis s'échauffent ensemble tout en se parlant, se marrant, "comme deux potes qui se retrouvent". Puis, naturellement, leur corps se rapprochent l'un de l'autre, se reconnectent, retrouvent les mouvements de leur adolescence, tant dans la fluidité que dans la force.
"A l'époque, nous avions déjà conscience que nous faisions quelque chose de brut, d'un peu violent", évoque Boris Charmatz. Trente ans plus tard, les corps ont changé.
"Jouer +A bras-le-corps+ est plus dangereux qu'avant", concède-t-il. Désormais âgés de 48 et 50 ans, Dimitri et Boris sont, à chaque représentation, aussi confrontés à leur passé. "Certains mouvements qui nous paraissaient géniaux à leur création nous semblent aujourd'hui ridicules, mais tant pis. C'est aussi ça, cette pièce… Elle a quelque chose d'unique".
Si l'on peut craindre d'un film qu'il vieillisse mal, "A bras-le-corps", dansée plus de 170 fois, ne suscite aucune lassitude.
Une arabesque aérienne vient contredire une glissade très ancrée dans le sol. Un dos s'enroule puis se projette. Le bras de l'un vient retenir celui de l'autre. Deux corps, massifs, s'accordent et se supportent. "A bras-le-corps" est un enchaînement d'instants corrosifs.
Elle révèle au spectateur le défi corporel -souvent dissimulé- qu'est la danse. Parfois, sous une lumière crue, Boris et Dimitri ont le souffle court. Ils joignent le son de leurs efforts à leur geste et le public se surprend à respirer avec eux.
L’espace scénique rectangulaire délimité par quelques rangées de bancs permet cette proximité. Au fil de la pièce, le public devient soutien, prête un genou en guise d’appui et laisse même une place aux danseurs dans les gradins, le temps d'une pause.
En 2017, la pièce, portée par la structure Terrain, est entrée au répertoire du ballet de l'Opéra de Paris. "C'est une chorégraphie de jeunesse", s'étonne encore Boris Charmatz. "On voulait faire un chef-d'oeuvre. On y a toujours cru, et on y croit encore beaucoup."