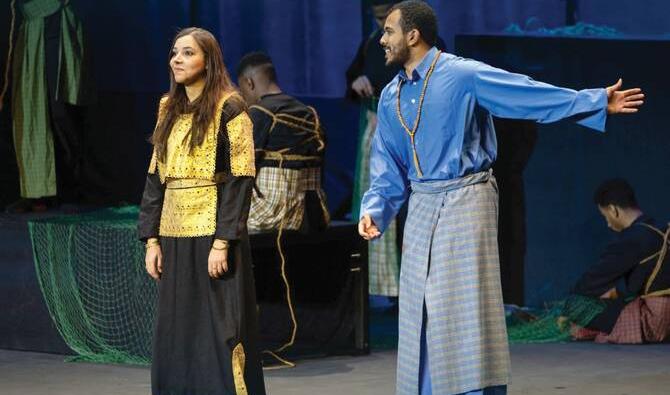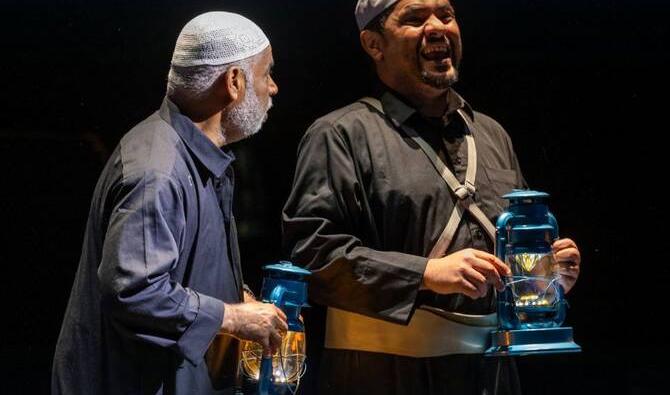LONDRES : Derrière la porte au bouton de porcelaine orné d'une rose, des tapis, couleurs chaudes, une ambiance de chambre d'étudiant. Jimi Hendrix a décrit l'endroit comme sa première « vraie maison », à Londres, ville qui a vu ce génie de la musique du XXe siècle exploser, puis s'éteindre il y a 50 ans.
Dans le quartier de Mayfair, au 23 Brook Street, le petit immeuble blanc a abrité en 1968 et 1969 le guitariste de légende, né à Seattle en 1942.
Après une enfance « très très malheureuse », l'armée, il « n'avait pas vraiment idée » de ce qu'est un « chez soi », explique Christian Lloyd, chercheur spécialiste de Jimi Hendrix.
Quand il arrive à Londres, en septembre 1966, le guitariste américain de 23 ans est totalement inconnu du public.
Dans l'avion qui le fait traverser l'Atlantique, résolu à se faire un nom, il décide de troquer Jimmy James pour Jimi Hendrix (son vrai nom de famille). « Le signe qu'il va se recréer à Londres », où « personne ne sait qui il est », souligne Christian Lloyd, « il peut être qui il veut ».
Quitte à prendre quelques libertés avec la réalité. Que ce soit pour entrer dans le pays - il s'était fait passer pour un auteur de chanson venu toucher ses royalties - puis dans ses premières interviews, sur son âge, sa famille, ou les raisons pour lesquelles il a dû quitter l'armée.
« Tout ce qu'il voulait, c'était jouer encore et encore », explique le chercheur, qui officie dans un institut anglais dépendant de l'université Queen's au Canada. Il enregistre « Hey Joe », « Are you experienced », son ascension est fulgurante.
La technologie des studios connaît des avancées majeures, permet de « nouveaux effets », Hendrix se distingue par son « authenticité » et cette « orientation futuriste, ce n'est possible qu'à Londres à l'époque », selon M. Lloyd.
Le fantôme de Haendel
Après avoir vécu d'un appartement à l'autre avec ses managers, Hendrix veut s'installer avec sa petite amie de l'époque.
C'est d'ailleurs elle qui a trouvé leur cocon, non sans mal. « J'étais allée chez un agent immobilier ou deux à Mayfair, mais dès qu'ils entendaient que c'était pour Jimi Hendrix, c'était non ! », s'est souvenue Kathy Etchingham en 2016 sur Channel 4. « Ils ne voulaient pas de quelqu'un comme lui ».
Dans le petit appartement, « il y avait de la moquette grise », que Jimi ne supportait plus, « on est allés chez John Lewis », un grand magasin d'Oxford Street, à deux pas, a-t-elle raconté.
Kathy Etchingham a de nouveau été mise à contribution pour recréer à l'identique la décoration de l'antre, reconvertie en musée depuis 2016, avec ses tapis persans, certains même enroulés tant Jimi Hendrix les accumulait. Dans la chambre baignée de rouge, orange, rose, cendrier plein, tasses à thé vides côtoient un Monopoly.
L'appartement n'était entouré que de magasins et de bureaux, « ce qui permettait à Hendrix de passer des disques aussi fort qu'il le voulait, de brancher sa guitare et jouer en plein milieu de la nuit s'il le voulait, aucun voisin pour se plaindre », explique Sean Doherty, responsable du musée.
Quand le couple s'est séparé et a quitté l'appartement en juin 69, Hendrix avait « donné pour instruction à son manager de vendre ou de se débarrasser de ce qui lui appartenait », poursuit-il. « On ne sait pas ce qui est arrivé à toutes ces choses ».
Plus de deux siècles auparavant, un autre génie de la musique a vécu là: Haendel. Enfin juste à côté, au 25, mais la plaque signalant l'illustre occupant se trouvait alors entre les deux immeubles, si bien que Hendrix a cru habiter chez lui. « Ils sont tous les deux musiciens, tous les deux immigrés, tous les deux novateurs », souligne Christian Lloyd, évoquant une anecdote selon laquelle Hendrix aurait un jour cru voir le fantôme de Haendel dans un miroir.
Comme les Rolling Stones ou les Beatles, Hendrix est « un personnage emblématique du Londres des années 1960 », ville qui « lui a permis de devenir lui-même ».
Il mourra le 18 septembre 1970 dans un hôtel du quartier de Notting Hill, emporté par un cocktail de médicaments et de vin, à l'âge de 27 ans.