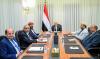PARIS: Ce n’est pas un procès classique qui s’ouvre aujourd’hui à Paris. Ni par son ampleur logistique, ni par sa nature. Une salle d’audience hors norme, pour un procès hors norme. Et pour cause: les accusés, dans ce cas précis, ne reconnaissent même pas l’existence de la justice française et ne se sentent donc pas concernés par une quelconque obligation de rendre des comptes. Pour eux, seule compte la justice divine.
Sur ce point, Anne-Clémentine Larroque, spécialiste de l’idéologie islamiste et chargée de cours à Sciences Po, est formelle: il y a chez des individus tels que Salah Abdeslam «un rejet de la république et un déni de la justice française», explique-t-elle à Arab News en français.
«Je suis allée en février 2018 à l’audience du procès de Salah Abdeslam», raconte l'historienne, qui affirme qu’il se joue dans le tribunal «autre chose que la simple application des principes juridiques», car le prévenu «ne reconnaît pas les lois de la justice des hommes; seule compte celle d’Allah».
La spécialiste insiste sur la confrontation qui est à l’œuvre entre deux systèmes de pensée totalement différents: celui d’une république démocratique et celui d’une idéologie salafo-djihadiste.
En réalité, c’est comme si ces personnes n’étaient même pas présentes au procès. Parfois, elles choisissent d’ailleurs de ne pas y assister: Amel Sakaou, l’une des accusées de l’attentat manqué à la bonbonne de gaz de Notre-Dame de Paris, est restée dans la souricière du tribunal. Elle refusera de comparaître tout au long du procès. Ayant fait le choix de ne pas être défendue à la barre, elle écopera de vingt ans de prison.
D’autres, qui acceptent de parler, ne veulent être jugés que sur les faits: pour eux, seul Dieu peut les interpréter, et ils nient aux avocats le droit de plaider.
L’enjeu du procès
Pour Anne-Clémentine Larroque, ce procès «a d’abord une dimension mémorielle historique».
«Il ne faut jamais perdre de vue que les valeurs de la démocratie sont toujours fragiles, qu’elles ne sont jamais acquises. On a tendance à être amnésique. Ce procès est un rappel à l’ordre sur une posture du système idéologique démocratique qui peut être parfois un peu arrogante. C’est un rappel de notre fragilité, de la nécessité de nous remettre en question.
Or, cela reste difficile dans un monde qui ne voit pas à long terme.
Le fait qu’il ait lieu pendant la campagne présidentielle ne va pas aider à rationaliser les fulgurances passionnelles et démesurées que l’action des djihadistes manifeste.»
«Aucun changement»
Dans le procès qui s’ouvre aujourd’hui à Paris, «on ne sait pas dans quelle posture les accusés vont s’installer», note Anne-Clémentine Larroque, qui ne s’attend quant à elle à «aucun changement» du côté de Salah Abdelslam. «Il va très probablement rester encore muré dans son mutisme», indique-t-elle, avant d’expliquer qu’il «ne peut discuter avec quelqu’un qui n’est pas “comme lui”, c’est-à-dire “musulman” selon sa propre acception de l’islam. Pour les islamistes, les musulmans deviennent “identitairement” ce qu’ils sont eux-mêmes», souligne l'historienne.
S’il fallait tenter de comparer le 13-Novembre au meurtre de Samuel Paty, lequel de ces deux événements pourrait-il être considéré comme central? Pour la chercheuse, il ne fait pas de doute que «les deux se complètent, dans la crise identitaire que traverse actuellement la France».
«Dans les deux cas, il y a une volonté de tuer une part de l’identité républicaine de la France. Ces deux actions, menées à cinq ans d’intervalle, se répondent et constituent un signal fort», martèle la chercheuse, qui précise que, paradoxalement, «notre modèle représente une menace pour notre propre société, car la majorité des auteurs des attentats sont français». «C’est comme si la société se tue elle-même», fait-elle observer.
«Les individus en question rejettent tellement le milieu duquel ils sont issus qu’ils veulent le tuer», ajoute-t-elle.
Elle estime d’ailleurs que «tout ce qu’on voit là sont des symptômes qui tirent leur racine d’un passé bien plus complexe entre la civilisation occidentale et la civilisation arabo-musulmane».
«Spectacularisation du phénomène»
Peut-on, dans ce contexte, parler d’éléments précurseurs aux attentats du 13-Novembre? Pour la chercheuse, il ne fait pas de doute que ces derniers existent: il s’agit de «tous les attentats perpétrés depuis le 11 septembre 2001, au moment où le terrorisme djihadiste devient visible et représente désormais une véritable force de frappe. Il y a alors une spectacularisation du phénomène».
Elle souligne à ce titre que le passage à l’acte de Mohammed Merah au mois de mars 2012 – lorsqu’il assassine un soldat français d’origine marocaine parce que ce dernier a servi en Afghanistan – est un événement qui a été «mal lu par la société française». À l’époque, en effet, on ne disposait pas des outils nécessaires pour mesurer l’envergure de cet acte. Anne-Clémentine Larroque rappelle que, avant d’agir, Merah est allé au Pakistan, «dans les zones tribales du Waziristan, pour aller chercher sa tazkiah [“recommandation”] auprès d’un djihadiste tunisien francophone du nom de Moez Garsallaoui».
Qui est Moez Garsallaoui?
Il vivait en Suisse depuis des années et était marié à Malika el-Aroud, une Belge d’origine marocaine surnommée «l’icône des djihadistes» ou «la veuve noire» car elle avait eu antérieurement pour époux Abdessatar Dahmane, alias Abou Obeyda, qui avait participé au meurtre du commandant Massoud, le 9 septembre 2001, dans le nord-est de l’Afghanistan. Garsallaoui sera tué au Pakistan par un drone lors d’un raid américain.
Bernard Squarcini, le directeur de ce qui était la DGSI (Direction générale de la sécurité intérieure, NDLR) à l’époque, l’actuelle DCRI, déclare alors que Merah n’est pas «un loup solitaire». La France comprend peu à peu qu’il existe une véritable mouvance, «mais cela prend du temps». Avec les attentats perpétrés contre Charlie Hebdo, le monde prend conscience de l’ampleur de ces actes. Il existe une véritable action dirigée contre la France puisque deux groupes terroristes se sont associés pour mener ces attaques: les frères Kouachi sont membres de l’Aqpa (Al-Qaïda dans la péninsule Arabique) et Coulibaly, quant à lui, a prêté allégeance à Daech. «Non seulement il s’agit d’actions projetées de l’étranger, mais c’est une combinaison de deux labels», explique Anne-Clémentine Larroque.
Loi confortant le respect des principes de la république: quelle portée?
Cette loi, qui a changé de noms à de nombreuses reprises, a pour origine le discours des Mureaux d’Emmanuel Macron, au mois d’octobre 2020. Il faut noter qu’il est prononcé quinze jours avant la décapitation de Samuel Paty, observe Anne-Clémentine Larroque.
Pour la chercheuse, même si ce discours intervient trop tard par rapport à l’ampleur du phénomène islamiste et à ce qu‘il signifie en France, sa portée symbolique ne doit pas être minimisée.
Cette prise de parole est en effet symbolique, car l’exécutif reconnaît l’existence d’une menace qui existe sur le territoire. Le mot qui a été utilisé est «islamisme», et non «islam». On vise donc ici l’idéologie qui a pour objectif de détourner l’islam et non la religion elle-même.