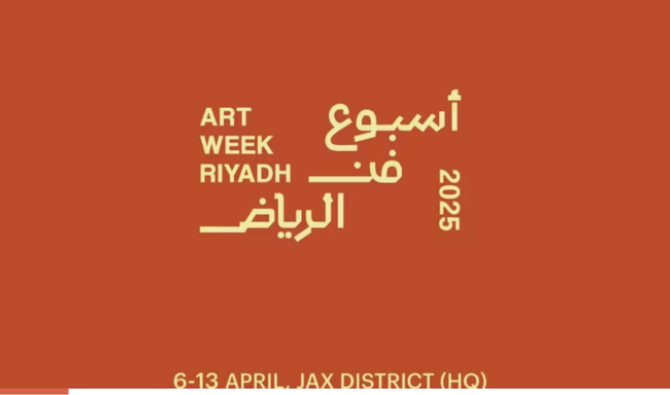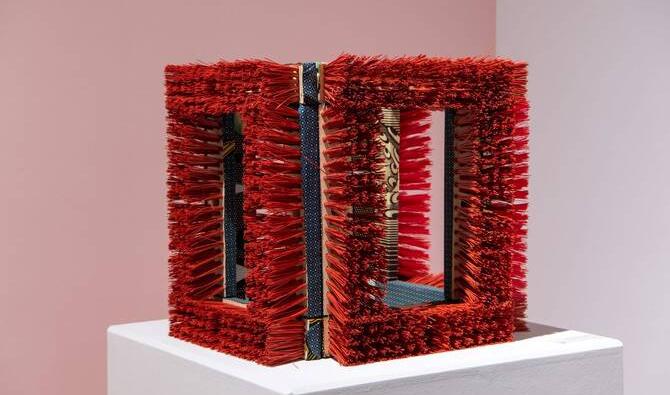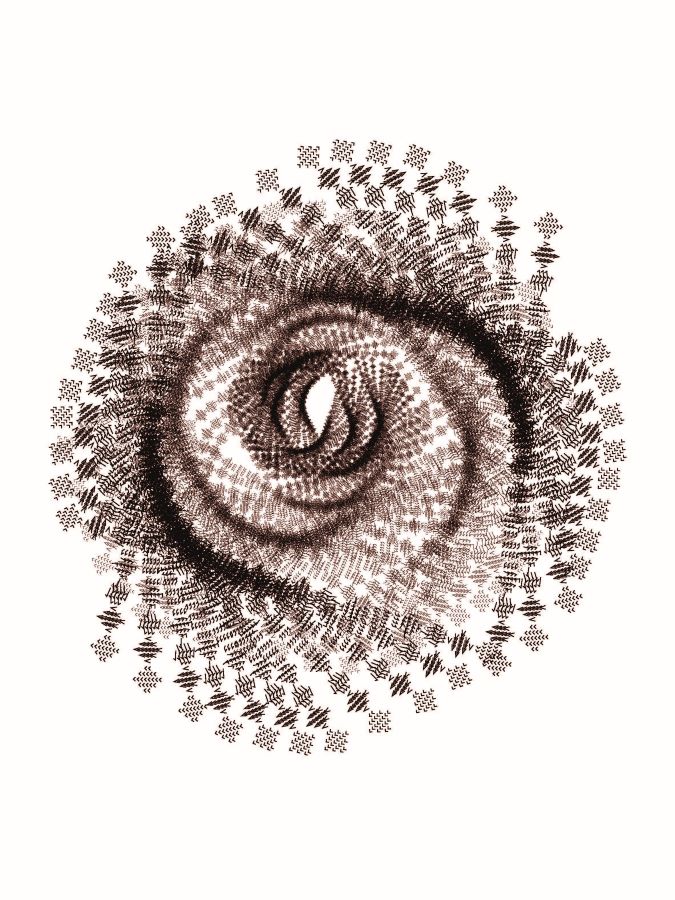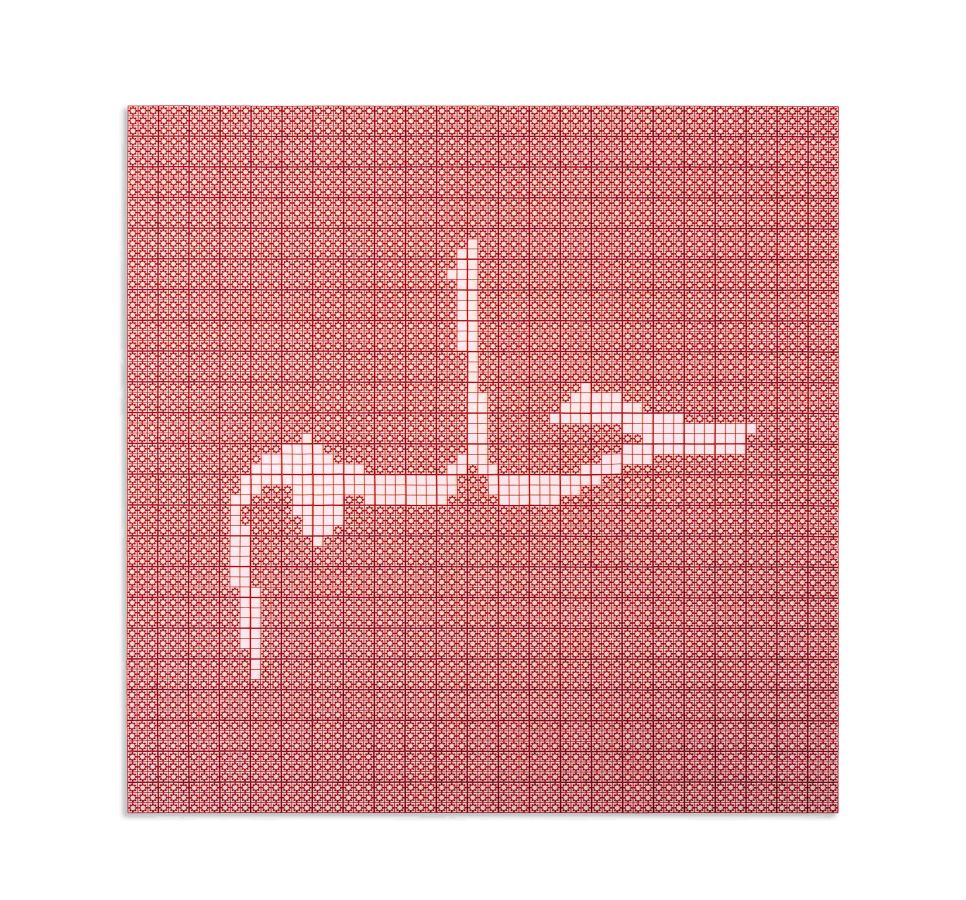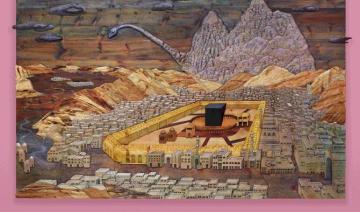PARIS: Après plusieurs mois de suspension en raison de la crise sanitaire, les manifestations culturelles reprennent en Algérie. Mise en place par l’Organisation nationale des éditeurs du livre (Onel), en collaboration avec le ministère de la Culture et des Arts, la première édition du Salon national du livre, sous le slogan «Un livre, une vie», s’est déroulée du 11 au 20 mars, au Palais des expositions, à Alger. Près de 200 maisons d’édition étaient présentes.
Même si le salon n’a pas drainé la foule du Salon international du livre (Sila), qui attire une moyenne de 100 000 visiteurs par jour, l’événement a le mérite de faire redémarrer le secteur qui souffre des répercussions de la crise sanitaire. Le salon a aussi pour objectif de faire connaître les jeunes auteurs, à l’image de Kahina Temzi, 16 ans, auteure d’un livre composé de seize textes, Tout ce que je n’ai pas su dire (éd. Imtidad).«Mes textes racontent la vie de tous les jours, mais aussi le ressenti du bonheur que j’écris sans tabou», a-t-elle expliqué. De son côté, Abdelmoaiz Farhi, 21 ans, a participé avec Fayla, un roman d’épouvante aux multiples rebondissements.
Sollicité par Arab News en français, Mohamed Abdallah, un jeune romancier français d'origine algéro-libanaise de 24 ans, répond à nos questions sur sa passion pour l’écriture, le rapport de la jeunesse algérienne à la littérature et les moyens mis en œuvre pour le développement de l’édition.

À 24 ans, vous avez quatre livres à votre actif…
J’ai publié quatre romans en Algérie: Entre l’Algérie et la France, il n’y a qu’une seule page, aux éditions Necib en 2017. Ce livre explore le dernier demi-siècle de relations algéro-françaises à travers le prisme de destinées individuelles ballotées par les flots de l’Histoire. Ensuite vint Souvenez-vous de nos sœurs de la Soummam, publié en 2018 aux éditions Anep (Agence nationale de l’édition et de la publicité). Ce roman aborde la condition féminine dans l’Algérie nouvellement indépendante, et se demande comment des femmes qui ont contribué à la libération de leur pays ont ensuite cherché à trouver leur place dans la société. Le livre raconte leurs combats, leurs rêves, leurs aspirations et les obstacles auxquels elles ont fait face.
Mon troisième ouvrage, Aux Portes de Cirta, a été publié en 2019 aux éditions Casbah. Ce roman historique plonge dans la Numidie antique et suit particulièrement l’épopée du roi Massinissa, contemporain d’Hannibal et Scipion, et fondateur d’un royaume prospère. Il interroge le rapport que nous entretenons avec notre passé et les leçons que nous pouvons en tirer. Enfin, mon quatrième roman, Le Vent a dit son nom, vient de paraître aux éditions Apic. L’histoire se déroule à Oran en 1954, elle questionne le rapport des écrivains, artistes et journalistes à l’engagement lors d’une période révolutionnaire, mais s’interroge aussi sur le rôle que la culture d’un pays peut tenir dans sa destinée historique.
Comment est née votre passion pour l’écriture?
J’ai toujours oscillé entre le monde des lettres au sens le plus «pur» et celui des questions politiques, sociales et historiques inhérentes à notre époque. Pendant mon adolescence, j’ai commencé à coucher sur le papier certaines de mes idées sans avoir encore la volonté d’écrire un roman. Au fil des ans, mon écriture est devenue plus cohérente, plus orientée vers un projet défini. Lorsque je me suis senti prêt, j’ai pris contact avec un éditeur. Je ne réalisais pas encore ce que signifie vraiment publier un roman, je voulais simplement donner corps à ce que j’avais réalisé. J’ai pris les choses comme elles se présentaient et, pour l’essentiel, mes impressions ont été très positives. J’ai été, la plupart du temps, reçu avec beaucoup de bienveillance et les critiques et conseils m’ont permis de progresser. Les rencontres avec les lecteurs m’ont révélé un nouvel aspect de l’écriture, celui de l’échange, prélude nécessaire pour moi à la phase plus solitaire de composition d’un roman. En somme, je suis reconnaissant à l’Algérie de m’avoir donné ma chance et permis de m’affirmer.
Quel est le rapport des jeunes à la littérature en Algérie?
Il y a un intérêt réel pour le livre en Algérie. La fréquentation record du Sila en est la preuve et, la jeunesse n’est pas en reste: Les échanges que j’ai eus avec des personnes de ma génération ont été parmi les plus intéressants. Si nous voulons aller plus loin et développer cet intérêt, il n’y a pas de secret: pour que la lecture soit toujours plus répandue, et mise plus en valeur pendant le parcours éducatif, non comme un outil assujetti à des causes plus importantes, mais comme un portail ouvrant vers des mondes immenses, dont l’exploration peut nous transformer. Dès que l’on prend conscience de son importance dans notre propre réalisation en tant qu’humains, le goût des lettres ne peut que suivre. Et c’est cette prise de conscience qui doit, à mon sens, faire plus que jamais partie de l’éducation des jeunes générations. Il ne faut cependant pas rester dans l’abstraction; il est nécessaire de présenter des récits vivants, prenants, qui donnent envie d’explorer davantage l’immense patrimoine offert par la littérature et les thèmes qu’elle aborde.
La 1re édition du Salon national du livre vient de se tenir à Alger. Cet événement est-il important pour relancer le monde de l’édition, malgré la baisse de fréquentation du public?
Ce salon est un premier signal important, un symbole de la vivacité de la culture. Ce n’est un secret pour personne: la crise induite par la pandémie (avec notamment l’annulation du Sila à l’automne dernier) a énormément touché le monde du livre et il était important de marquer son retour sur le devant de la scène.
Si nous voulons sortir de cette zone de turbulences, il sera aussi important de renforcer et de favoriser tout l’écosystème du livre, de multiplier les rencontres à travers le pays et de leur assurer une couverture médiatique importante. Il m’est arrivé de souhaiter, en ne plaisantant qu’à moitié, de voir le Sila reconduit en permanence. L’effervescence autour du livre doit être maintenue tout au long de l’année. Des initiatives comme ce Salon national à Alger sont un premier pas, puisque cela a permis aux éditeurs qui ont eu le courage de ne pas plier pendant la crise, de proposer aux lecteurs leurs toutes dernières publications. Ce salon ne doit pas rester une mesure d’urgence ou d’exception, mais une étape dans l’épanouissement de la littérature algérienne.