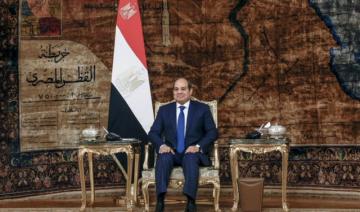ISTANBUL : Le président Recep Tayyip Erdogan et son parti de la Justice et du développement (AKP) dominent la vie politique en Turquie depuis vingt ans.
Certains pans de la société en ont tiré bénéfice, d'autres y ont perdu, dans un pays polarisé. Quelques exemples à la veille des élections présidentielle et législatives du 14 mai.
Les gagnants
LES RELIGIEUX
La direction des affaires religieuses, ou Diyanet, est devenue une force sociale puissante sous M. Erdogan, lui-même un pieux musulman dont le parti islamo-conservateur a défié les fondements laïcs de la Turquie post-ottomane. Le Diyanet dispose de sa propre chaîne de télévision, qui pèse sur le débat politique, et bénéficie d'un budget comparable à celui d'un ministère de taille moyenne. L'étendue de ses prérogatives en a fait une cible des adversaires laïques du président qui se plaignent de l'augmentation du nombre des mosquées, des cours de Coran et de l'influence des confréries religieuses. L'ancien chef du Diyanet, Mehmet Görmez, s'est ainsi retrouvé mêlé à un scandale sur son style de vie jugé somptueux.
LE SECTEUR IMMOBILIER ET LA CONSTRUCTION
Sous M. Erdogan, l'immobilier et les grands chantiers se sont développés partout en Turquie, stimulant la croissance. Certains groupes et entrepreneurs considérés comme proches du gouvernement se sont vu octroyer des marchés publics juteux. Cette frénésie a remodelé ce pays, offrant des logements neufs à des millions de personnes tout en modifiant profondément la silhouette de villes comme Istanbul, soudain couvertes de gratte-ciel. Cette frénésie de développement a accompagné l'appétit du chef de l'Etat pour les "projets fous", de méga-investissements ambitieux de plusieurs milliards de dollars - ponts, autoroutes, aéroports,etc. - dont le Canal Istanbul, imaginé pour doubler le Bosphore mais toujours dans les limbes.
LES FEMMES CONSERVATRICES
M. Erdogan a défendu les droits des musulmans conservateurs après des décennies d'un régime résolument laïc. Les femmes pieuses ont ainsi été progressivement autorisées à porter le foulard - jusqu'alors interdit de fait - dans les universités, la fonction publique, la police et au parlement. Le chef de l'Etat en a fait une affaire personnelle parce que ses deux filles, couvertes comme leur mère, n'avaient "pas été autorisées à porter le foulard" à l'université.
Les perdants
LES MEDIAS
Le paysage médiatique turc, autrefois cité en exemple pour son pluralisme, s'est progressivement étriqué sous M. Erdogan. Les observateurs estiment que 90% des médias turcs sont désormais sous le contrôle du gouvernement ou de ses partisans. Le président sortant a favorisé l'acquisition de journaux et de chaînes de télévision par des hommes d'affaires proches du pouvoir auxquels des prêts publics ont été accordés. Parallèlement, s'engageait la répression des voix critiques, en particulier de celles des médias kurdes, encore renforcée après le coup d'État manqué de 2016. Selon l'association turque P24, soixante-quatre journalistes sont actuellement emprisonnés.
LES MILITAIRES
L'armée turque, profondément laïque et coutumière des coups d'État, a progressivement perdu son influence sur la scène politique. Le processus s'est accéléré après qu'une faction a organisé une tentative de coup d'État en 2016, imputée à un prédicateur musulman exilé aux États-Unis. Le président Erdogan a répliqué par des purges qui ont envoyé des milliers de soldats en prison – à vie pour des centaines d'entre eux. Les militaires ayant les grades les plus élevés ont été décimés, altérant les capacités de la principale force sur le flanc oriental de l'Otan. L'armée de l'air, en particulier, a perdu nombre de ses pilotes et de ses officiers.
Bilans nuancés
KURDES
Réprimés par les gouvernements laïcs comme la plupart des minorités en Turquie, les Kurdes ont aidé M. Erdogan à se faire élire et l'ont soutenu à ses débuts. Le chef de l'Etat a tenté de promouvoir leurs droits culturels et linguistiques, ouvrant des négociations pour mettre fin à la lutte armée d'une partie d'entre eux et leur octroyer une plus large autonomie dans le sud-est. Mais après l'échec de ces pourparlers et une flambée de violences en 2015-2016, la communauté kurde (15 à 20 millions de personnes) s'est retrouvée sous une pression croissante. Des dizaines de dirigeants kurdes ont été emprisonnés ou démis de leurs fonctions électives. Le principal parti prokurde, le HDP, dont le chef de file est emprisonné, risque d'être interdit comme bien d'autres avant lui, accusé de "terrorisme".
En Turquie, les Kurdes tournent le dos à Erdogan
Épuisé par la répression menée dans la région à majorité kurde de Turquie, Ali votera le 14 mai pour le principal opposant au président Recep Tayyip Erdogan.
"Il est temps de changer", déclare à l'AFP cet habitant de Diyarbakir (sud-est), la "capitale" officieuse des Kurdes de Turquie.
"Pour quiconque regarde la télévision, les Kurdes sont des terroristes", déplore le quinquagénaire, qui refuse de décliner son nom complet par crainte de représailles.
Sans le nommer, Ali explique qu'il votera pour Kemal Kiliçdaroglu, le chef du Parti républicain du peuple (CHP, social-démocrate), à la tête d'une coalition de six partis.
"Mais je mentirais si je disais que je (lui) fais entièrement confiance", confie-t-il.
Les Kurdes - environ un cinquième des 85 millions d'habitants - ont été persécutés dans la Turquie post-ottomane créée par Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur du CHP.
La république moderne a nié l'existence même de la communauté, privant les Kurdes de leurs droits à la culture et à leur langue.
Lors de son arrivée au pouvoir en 2002, le parti AKP (islamo-conservateur) du président Erdogan a été populaire parmi les Kurdes, en recherchant un accord pour mettre fin à la lutte sanglante des Kurdes pour leur autonomie.
Mais l'échec de ces pourparlers en 2015 a conduit à la reprise du conflit armé opposant l'État turc au PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, groupe armé qualifié de terroriste par Ankara et ses alliés occidentaux.
«Piro»
L'alliance nouée récemment entre Erdogan et le Hüda-Par, formation d'extrême droite, a également rouvert des plaies.
Le Hüda-Par est lié au mouvement kurde Hezbollah - distinct du groupe chiite libanais du même nom -, composé d'islamistes sunnites et impliqué dans les meurtres de militants kurdes et féministes dans les années 1990.
Certains analystes ont vu dans le Hezbollah kurde un outil des autorités pour combattre l'insurrection du PKK.
Pour Eyüp Burç, fondateur de la chaîne de télévision prokurde IMC, désormais fermée, le soutien d'Erdogan au Hüda-Par trahit sa crainte de perdre des voix y compris chez les Kurdes les plus conservateurs.
"Les sondages montrent environ 15% de soutien à Erdogan à Diyarbakir et ça continue de fondre", relève-t-il.
Le CHP dirigé par Kemal Kiliçdaroglu est presque invisible à Diyarbakir, mais le candidat de 74 ans s'attire des sympathies en raison de sa foi alévie - et de son identité kurde, même discrète.
La plupart des Kurdes le surnomment "Piro", qui vient de "pir", mot kurde qui signifie grand-père et décrit également un chef religieux alévi.
LA CLASSE MOYENNE
La Turquie a connu un boom économique au cours de la première décennie au pouvoir de M. Erdogan, générant une nouvelle classe moyenne florissante. Mais, depuis 2013, l'économie passe d'une crise à une autre. Selon la Banque mondiale, le produit intérieur brut actuel de la Turquie - qui mesure la richesse d'un pays - est retombé au niveau des cinq premières années au cours desquelles M. Erdogan a été au pouvoir. Avec une inflation officielle de plus de 85% atteinte l'an dernier, les économies de millions de ménages sont parties en fumée. Et de nombreuses familles peinent à finir le mois désormais.