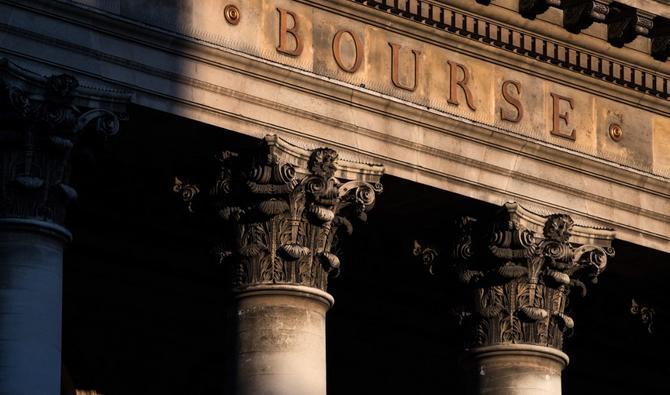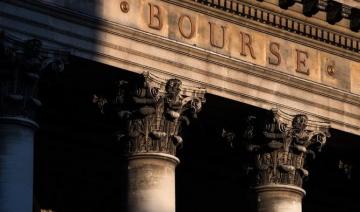PARIS: Acheter la même quantité mais moins cher: l'inflation pousse les consommateurs à revoir la composition de leur panier et à "glisser" vers les gammes de prix inférieures, une situation qui profite aux enseignes identifiées comme les moins chères, ainsi qu'aux marques de distributeurs bon marché.
"Depuis le début de l'épisode d'inflation, on voit que ces produits-là montent très fort", dans un contexte où les consommateurs veulent "continuer à acheter à peu près la même quantité" en payant moins cher, relève l'experte en produits de grande consommation chez IRI, Emily Mayer.
L'inflation s'élevait à 5,8% sur un an en juin selon l'Insee, et à 5,7% dans l'alimentaire, forçant de nombreux ménages à "descendre en gamme" de prix pour rester dans les limites de leur budget.
Les spécialistes notent que la clientèle des marques nationales (MN) et du bio, plus onéreux, se tourne de plus en plus vers les marques de distributeur (MDD) telles que "Marque Repère" (E.Leclerc), "Bouton d'or" (Intermarché), "Reflets de France" (Carrefour). Ces références créées, détenues et vendues par les enseignes sont en moyenne 20 à 30% moins chères que les produits équivalents de grandes marques.
Selon une étude de l'Observatoire Société & Consommation, parmi les 39% de Français qui disent "restreindre" leurs dépenses alimentaires en 2022, 78% "renoncent aux grandes marques pour les MDD".
Parmi ces dernières, l'offre premier prix connaît la progression la plus rapide. "Top Budget" (Intermarché), "Éco+" (E.Leclerc) ou encore "Simple" (Carrefour) peuvent être "40 à 50% moins chères" que les marques nationales.
Les marques de distributeur, atout des enseignes face à l'inflation
Qu’est-ce qui distingue une tablette de chocolat Nestlé, une autre de marque Monoprix, ou "Marque Repère" ? A priori, peu de chose, mais la première est une marque nationale, les secondes des marques de distributeur, ou "MDD", et la différence est loin d’être neutre.
Les MDD, des lignes de produits créées, détenues et dont les caractéristiques sont définies par les enseignes qui en assurent la commercialisation pesaient en 2021 plus de 30% des produits de grande consommation (PGC) vendus en France, selon NielsenIQ.
Ce sont les "Marque Repère" (E.Leclerc), "Reflets de France" (Carrefour), "Labell" (Intermarché)... La plupart des distributeurs en possèdent une ou plusieurs.
Certaines couvrent les recettes régionales, d'autres les articles de base premier prix, les produits bio, le bricolage... Et différentes gammes de prix.
Dans les enseignes comme Netto ou Lidl, elles représentent même la majorité des références mises en rayon, voire l'intégralité pour Aldi.
En raison de la forte inflation, elles sont particulièrement mises en avant par les enseignes: les marques de distributeur du coeur de marché sont en général 20 à 30% moins chères que leur équivalent en marque nationale.
"Le principe des marques de distributeur est d'offrir une alternative aux marques nationales avec un niveau de qualité équivalent pour un prix inférieur", résume le président des marques de distributeurs alimentaires d'E.Leclerc, Fabrice Hersent.
Elles peuvent même être 50% moins chères pour les marques de distributeur dites "économiques" comme "Top Budget" (Intermarché), "Tous les jours" (Casino) ou "Éco+" (E.Leclerc), explique l'experte en produits de grande consommation d'IRI, Emily Mayer.
Les commerçants expliquent soustraire "tout ce à quoi les clients sont prêts à renoncer", sauf la qualité, affirme la directrice des Marques de Carrefour Martine Loyer.
Les marques de distributeur les moins chères "ne bénéficient pas toujours des dernières innovations packaging comme des ouvertures faciles", relève Fabrice Hersent. Ni des mêmes campagnes promotionnelles que les grandes marques.
«Notre cahier des charges»
Il existe une autre différence de taille: alors que les produits de marques nationales font l'objet de négociations annuelles entre commerçants et industriels, les marques de distributeur fonctionnent par appels d'offre à durée variable, ou négociation de gré à gré.
"Vous mettez votre cahier des charges en termes de qualité (...) et vous l'envoyez aux différents fabricants, fournisseurs, qui peuvent faire ce produit-là", détaille le président d'Intermarché-Netto, Vincent Bronsard.
Les contrats restent assez flexibles, grâce à la relation "en direct" qui unit les distributeurs et leurs fournisseurs. "En termes de négociations, ça se fait tous les jours", "il y a ce partenariat permanent" surtout en période de forte variation des prix, indique la directrice des Marques de Carrefour, Martine Loyer.
"Vous n'avez pas cet échange là sur une marque nationale, parce que c'est un produit acheté sur catalogue", développe-t-elle. "Là, c'est notre produit, avec notre cahier des charges et donc on peut faire des arbitrages ensemble" sur les coûts, voire "simplifier un produit".
Nouveaux clients
Carrefour et E.Leclerc ont ainsi enregistré en juin une nette hausse des ventes de leurs marques "économiques" (+15% et +16%), par rapport à la même période en 2021, ont-ils indiqué.
"Les plus touchés (par l'inflation) sont en train de se réfugier dans les premiers prix", commente la directrice des Marques de Carrefour, Martine Loyer.
Le rebond est "d'autant plus net que ces produits-là étaient en recul" ces dernières années, observe Emily Mayer, d'IRI. Les consommateurs ressentaient moins le besoin d'acheter à bas prix car "on avait un pouvoir d'achat qui progressait", renchérit le président d'Intermarché-Netto, Vincent Bronsard.
"Dans le contexte inflationniste" actuel, les magasins identifiés comme les moins chers et qui commercialisent en majorité leurs propres marques conquièrent de nouvelles clientèles, selon le panéliste Kantar.
Lidl, ex-discounter, est le plus dynamique. Il a recruté 784 000 nouveaux foyers entre le 16 mai et le 12 juin, contre 430 000 nouveaux clients pour son principal concurrent Aldi.
Pour Netto, sur ce même créneau, la fréquentation a aussi bondi, indique Vincent Bronsard. L'enseigne a attiré en six mois "1,4 million" de nouveaux clients.
L'inflation, alliée inattendue des courses anti-gaspi
Dates courtes, produits "moches", particulier à particulier... le secteur de l'anti-gaspi surfe sur la hausse des prix pour s'imposer comme une nouvelle "routine de consommation", entre perspectives d'économies et quête du manger mieux.
Depuis le 7 juillet, l'hypermarché Carrefour de Montesson (Yvelines) est devenu un refuge pour produits "moches". Concombre tordu, poivron rouge taché de vert ou camembert un peu trop léger pour en revendiquer l'appellation, ces articles jusque-là sans débouchés ont trouvé une place en rayon.
Circonspects dans un premier temps, les curieux font les yeux ronds devant leur prix: "20 à 25% moins cher" que leur équivalent coeur de marché, affirme le magasin.
L'initiative anti-gaspi tombe à point nommé alors que l'inflation s'élevait à 5,8% sur un an en juin selon l'Insee, et à 5,7% dans l'alimentaire.
"C'est une opportunité d'achat" pour des clients qui se seraient autrement privés de viande ou de fruits à cause de la hausse des prix, a expliqué lors d'une visite le directeur RSE (responsabilité sociétale et environnementale) de Carrefour, Bertrand Swiderski.
L'objectif est d'avoir une "offre moins standardisée", a poursuivi le cofondateur de "Nous anti-gaspi" Charles Lottmann, partenaire du projet et créateur de la gamme. "Souplesse" sur l'aspect des produits, "dates courtes" ou "poids variable", celle-ci a été victime de son succès et les étals dévalisés, a assuré M. Swiderski.
Nouvelle routine
Les achats anti-gaspi étaient d'abord perçus comme un "engagement écologique", estime Jean Moreau, cofondateur de l'application spécialisée dans les invendus, Phenix. Mais ils "sont en train de devenir une routine de consommation" en réponse "à la problématique du pouvoir d'achat", ajoute-t-il.
"On a en moyenne 12% d'inscriptions en plus" par mois depuis le début de l'année par rapport à l'année précédente, poursuit M. Moreau. L'application a dépassé les 4 millions d'utilisateurs en séduisant de nouveaux profils comme les personnes âgées et en renforçant sa base d'étudiants, attirés par les ristournes de "50% au minimum".
La tendance est encore plus forte chez le leader du secteur, TooGoodToGo. "Rien qu'au mois de juin, les téléchargements ont bondi de 42% par rapport à juin 2021" et la fréquence d'achat augmente, a indiqué à l'AFP sa directrice France, Sarah Chouraqui.
Déjà familier de ces plateformes, Fabien Da Silva, alternant en informatique de 24 ans, multiplie les commandes pour réduire les effets de la hausse des prix sur sa consommation. "Je prends régulièrement un panier contenant 3 à 4 articles de viande, j'évite de les acheter en supermarché car je ne peux pas me le permettre", développe-t-il.
"Je commande quasiment tous les jours", témoigne de son côté Thomas, cadre de 47 ans qui souhaite garder son anonymat pour des raisons professionnelles. "Le chômage partiel a réduit mon train de vie", développe-t-il, les paniers anti-gaspi lui permettent ainsi de "manger pour 5 à 8 euros par jour", contre "15 à 20 euros" auparavant, de quoi réduire les effets de l'inflation.
Particulier à particulier
La dynamique s'est propagée à des réseaux locaux plus confidentiels, qui prônent des échanges directs entre petits producteurs et clients, voire de particulier à particulier.
Il s'agit de "remettre au goût du jour cette pratique qu'on avait, de donner (ou vendre à prix cassé) les légumes qu'on avait en trop dans son jardin, quand on ne pouvait pas les consommer", explique Inès Bazillier de Fruit and Food.
Née il y a un an et implantée surtout dans le sud-est, la start-up a recruté un quart de ses 8.000 membres ces dernières semaines, boostée par une envie constante des Français de manger "sain et local" malgré la hausse des prix.
Certains "payent pour un kilo d'abricots mais repartent avec une caisse de cinq kilos" grâce à la générosité du jardinier, d'autres viennent chez l'habitant "cueillir directement sur l'arbre, et gratuitement", s'amuse Mme Bazillier, qui dénombre autant d'habitués des circuits courts que d'utilisateurs "en recherche de bons plans".
Qualité «quasiment similaire»
Les marques de distributeur dites "classiques" (par opposition aux premiers prix) ont retrouvé leur vitalité depuis le début de la crise inflationniste, attirant toutes sortes de publics, y compris des ménages au pouvoir d’achat plus élevé.
Ces produits sont longtemps restés impopulaires: les consommateurs rechignaient à les mettre dans leur panier, redoutant une qualité moins bonne que celle proposée par les grandes marques, ou butaient sur le manque de choix.
La valeur nutritionnelle est pourtant "quasiment similaire", rassure la nutritionniste Anne-Laure Laratte, en particulier sur les aliments de base (riz, pâtes, thon en boite...). "La différence se fait surtout sur le marketing" et sur la composition des "produits transformés".
Avec l'inflation, les distributeurs étendent leur offre et remettent leurs propres marques en évidence, avec la promesse de payer moins cher sans perdre en qualité.
"Ce n'est pas triste" d'acheter des marques de distributeur, conclut Vincent Bronsard. "Si la crise s'arrête, nous allons retrouver les tendances comme le bio, le +mieux manger+". Mais pour l'heure, des habitudes d'économies sont prises. "Et elles vont rester", prédit-il.