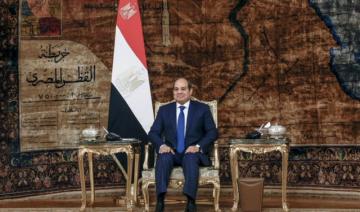ISTANBUL : La ruelle est plongée dans le noir. Un camion stationne, la remorque pleine d'énormes ballots de tissus. Six hommes patientent en file indienne, dont Bayram Yildiz, prêt à charger sur son dos un paquet que trois hommes peinent à soulever.
Bayram, 1m85 pour 105 kilos, est un "hamal", un porteur. Dans ce quartier de grossistes situé à deux rues du Grand bazar d'Istanbul, ils sont plusieurs centaines, dès l'aube, à charger et décharger des camions et grimper dans d'étroites cages d'escaliers, le dos parfois courbé sous plus de 100 kilos de marchandises.
"Je suis mi-Hercule mi-Rambo", sourit Bayram, 40 ans, qui affirme porter jusqu'à 200 kilos. Le père de famille, qui perpétue ce métier ancestral depuis vingt ans, dit gagner "200, 300 livres" par jour (entre 18 et 27 euros), parfois plus.
Derrière lui, un homme avance au ralenti. De profil, seules ses jambes sont visibles. Son visage, son ventre et ses bras ont disparu sous l'énorme ballot blanc qu'il transporte.
"C'est le pire métier, mais il n'y a rien d'autre", lâche Osman, porteur depuis trente-cinq ans.
Dans le quartier, où se vendent vêtements, tissus ou rideaux en gros, tout ou presque se transporte à dos d'hommes. Des diables à roulettes sont visibles çà et là, mais ils sont peu pratiques pour monter dans les étages, font valoir les porteurs.
Pour répartir le poids des charges et les stabiliser, ils enfilent des selles de portage à bretelles faites de paille, de cuir et de tissus, semblables à celles utilisées par les porteurs de l'Empire ottoman.
A l'époque, beaucoup étaient Arméniens. Aujourd'hui, le métier - souvent transmis de père en fils - est tenu par des hommes majoritairement kurdes, originaires des provinces de Malatya et Adiyaman, situées dans le sud-est de la Turquie.
"Les [porteurs] de Malatya et Adiyaman ont su créer une confiance" avec les commerçants "à une époque où il n'y avait pas de téléphones portables" et où tout reposait sur l'oral et le bouche-à-oreille, explique l'historien Necdet Sakaoglu.
Selon lui, c'est au début du 19e siècle, sous le sultan réformiste Mahmoud II (1808-1839), qu'Istanbul - alors Constantinople - a compté le plus grand nombre de porteurs.

Mais aujourd'hui encore, dans ces ruelles grouillantes de la vieille ville où les ascenseurs sont rares, "les porteurs sont une nécessité", juge-t-il.
«Ce métier est fini»
La plupart des porteurs travaillent en escouades, sous l'autorité d'un chef. C'est lui qui assure la coordination avec les commerçants et distribue la paie à la fin de la journée. Chaque escouade contrôle un micro-quartier.
"Si j'essaie d'y aller, ils ne me laisseront pas. C'est leur quartier", explique pudiquement Mehmet Toktas, porteur indépendant, au sujet des rues voisines de la sienne.
Depuis trente ans, le presque quinquagénaire, physique de lutteur, monte et descend six jours sur sept, paquets sur le dos, les marches d'un seul et même immeuble de sept étages où s'entassent 120 grossistes en textile.
"Ici, nous étions quatre, cinq personnes. Les plus âgés sont partis, je suis le seul à être resté", confie-t-il, debout sous un néon qui éclaire d'une lumière blafarde le couloir du rez-de-chaussée où il passe une partie de ses journées.
"A l'époque, ça payait bien, on gagnait plus que le salaire minimum [moins de 320 euros brut mensuels]. Mais maintenant, avec la quantité de travail qui diminue, ça ne rapporte plus autant", regrette le père de quatre enfants.
Sans assurance ni sécurité sociale, Mehmet Toktas, qui dit gagner entre 150 et 200 livres (13 et 18 euros) par jour, tâche de préserver son dos pour travailler jusqu'à 60 ans. "Tous ceux qui sont plus vieux que moi se sont fait opérer des genoux ou du dos", assure-t-il.
Dans le quartier, des porteurs ont l'allure de vieillards, cheveux blancs et jambes sèches comme des échalas. Certains travaillent jusqu'à 70 ans, malgré les hernies et les genoux abîmés.
Mais pour les grossistes du quartier, les porteurs sont précieux : "Ils sont un maillon auquel on ne peut pas renoncer", dit Kamil Beldek, derrière le comptoir de sa boutique microscopique. "Pour nous ce qu'ils font semble très difficile, mais pour eux c'est facile."
Mehmet Toktas se sent utile, mais "ce métier est fini", croit-il. Les étages supérieurs de son immeuble "sont tous vides", certains grossistes ayant préféré déménager loin du centre. "Dans 10, 15 ans, ce travail n'existera plus."