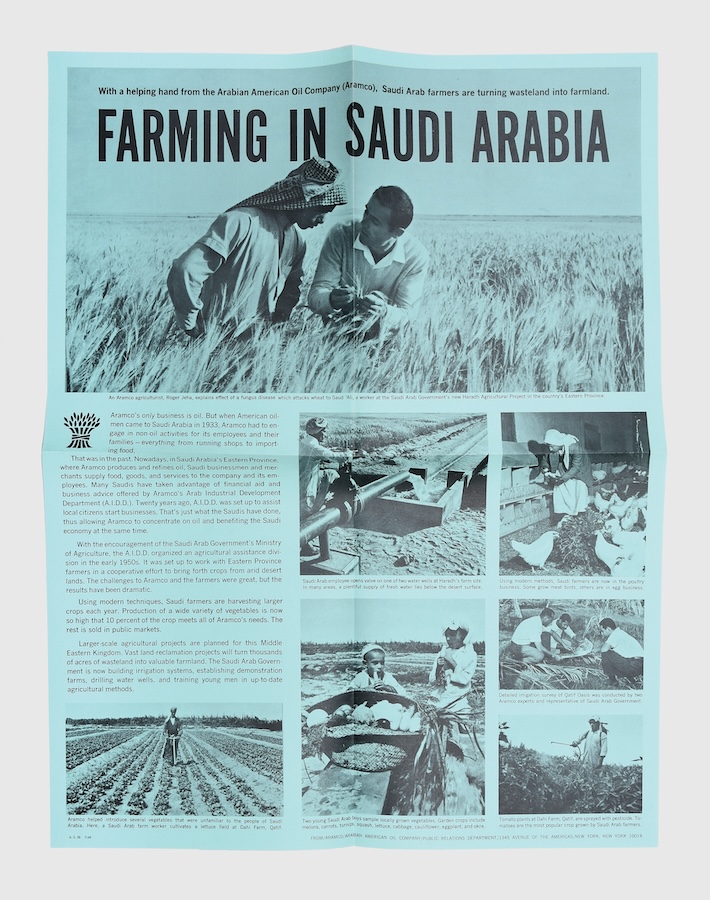PARIS: Programmée du 26 juin au 28 novembre 2021 à la Maison des arts/centre d’art contemporain de Malakoff, dans le département des Hauts-de-Seine, «Quelque part entre le silence et les parlers» ravive les souvenirs d’un voyage en Algérie effectué par Florian Gaité, docteur en philosophie, critique d’art et commissaire de cette exposition.

Cet événement «cherche à faire entendre les voix et le silence qui caractérisent si bien l’Algérie; c’est une oreille tendue par-delà la Méditerranée», précise à Arab News en français Florian Gaité lors de notre visite. «C’est un pays aussi familier que méconnu, et dont la complexité – sociale, politique, historique – est à la mesure de la diversité culturelle qui s'y exprime», affirme-t-il.
«J’ai monté ce projet avant que le Hirak ne prenne forme, au mois de février 2019, ce qui a bouleversé ma vision de la scène algérienne, un pays que je ne connaissais pas, au sujet duquel j’avais des préjugés, des idées préconçues, une grille de lecture exclusivement occidentale», nous raconte Florian Gaité, dont la grand-mère est née à Oran.

«Expérience sensitive et sensorielle»
«Lorsque je suis arrivé, je me suis rendu compte que l’expérience sensitive et sensorielle que l’on éprouve en l’Algérie était constituée de deux pôles: d’un côté, c’est un pays extrêmement loquace, où l’on parle une multiplicité de langues, une sorte de bricolage langagier. D’une ville à l’autre, d’une génération à l’autre, on ne parle pas de la même façon. La génération des grands-mères parle amazigh, leurs enfants s’expriment en français et en arabe, et la jeune génération s’oriente davantage vers la langue arabe et l’anglais. Cette stratification des langues me paraissait folle car, par ailleurs, en Algérie, il y a aussi beaucoup de silence. C’est un pays où l’on chuchote, où il y a de la pudeur, car on ne dit pas tout», confie-t-il.

Pour lui, l’Algérie est un pays marqué par de nombreux traumas et par une forme de rétention car, d’une génération à une autre, on ne raconte pas les mêmes blessures. «Il y a deux écueils que je voulais éviter: le premier résidait dans le fait de me placer en critique occidental qui viendrait évoquer la scène artistique algérienne, sujet dont je ne suis pas un spécialiste. Le second consistait à choisir les artistes comme de simples intermédiaires pour témoigner de la scène artistique algérienne. En effet, ils connaissent leur pays mieux que moi et leurs témoignages sont, à mon sens, plus justes et plus authentiques», nous révèle-t-il.

«Fonction testimoniale et documentaire»
Selon l’organisateur de l’exposition, la colonisation, l’islamisme, l’autoritarisme d’État constituent quelques-uns des multiples traumas de l’histoire contemporaine de l’Algérie. «Ce sont des successions de causes, d’interdits, de dénis, de refoulements qui inhibent la parole et empêchent souvent de la retranscrire sous forme de récit. L’apparition de la fonction testimoniale et documentaire dans l’art algérien contemporain répond ainsi à cette nécessité de témoigner du passé comme du présent – colonisation, guerre de libération, socialisme, décennie noire, ère Bouteflika, Hirak – et de proposer des réécritures, d’exhumer ce qui a été effacé ou falsifié, de donner une voix à tous les oubliés», souligne-t-il.
«Quelque part entre le silence et les parlers» réunit des artistes qui sont nés, vivent ou travaillent en Algérie: Louisa Babari, Adel Bentounsi, Walid Bouchouchi, Fatima Chafaa, Dalila Dalléas Bouzar, Mounir Gouri, Fatima Idiri, Sabrina Idiri Chemloul, Amina Menia et Sadek Rahim. Ces créateurs algériens ou franco-algériens ont été sélectionnés par Florian Gaité, qui précise que certains d'eux sont encore peu représentés dans les lieux d'art en France. «Cette représentation, composée de plus de femmes que d’hommes, présente des œuvres réalisées avec des matériaux divers comme le papier, le charbon ou encore le tissu», indique le commissaire de l’exposition lors de notre rencontre.
Lors de son séjour à Oran, Florian Gaité a rencontré Sabrina Idiri Chemloul, une réalisatrice franco-algérienne, lors d’une manifestation du Hirak. Originaire, comme lui, de la ville de Pantin, dans la région parisienne, l’artiste lui a présenté sa maman, Fatima Idiri.
Née dans les Aurès, au nord-est de l’Algérie, Fatima Idiri a vécu à Nancy dans une famille qui fait partie des réseaux de résistants du Front de libération nationale (FLN). Rentrée au pays après l’indépendance, elle s'intéresse en autodidacte à l’art, du stylisme-modélisme à la peinture sur soie, de la mosaïque à la broderie berbère. Fortement influencée par l’impressionnisme et l’orientalisme, elle réalise des copies de tableaux. «La ferveur du Hirak a changé la donne: cela lui a donné l’envie de peindre ses propres tableaux. En choisissant le dessin figuratif comme identité artistique, elle cherche, à travers son œuvre, à perpétuer la mémoire de l’une des traditions de sa région natale, les Aurès», nous confie Florian Gaité.
«En réalisant ses œuvres avec du marc de café et de l’acrylique, l’artiste a souhaité rendre hommage à des poétesses et des chanteuses libres et émancipées qui sont les Azriat», indique-t-il, avant de préciser que l’artiste a longuement étudié des clichés de la photographie coloniale et qu’elle a cherché à les déconstruire afin de retrouver la spontanéité et la nature profonde de ces artistes avant-gardistes qui étaient mal vues, voire marginalisées, dans la société de la période coloniale.

Tableaux poignants de harraga
Dans les locaux de la Maison des arts de Malakoff, on trouve aussi des œuvres de Mounir Gouri. Cet artiste originaire d’Annaba a gagné le Prix des amis de l’IMA (Institut du monde arabe). Installé en France, Mounir Gouri présente des tableaux poignants de harraga (voyageurs clandestins). Il parvient à transformer leur périple en performance. Florian Gaité évoque le tableau en particulier, qui représente un ciel étoilé, peint avec du charbon. «Le message de l’artiste consiste à dire que, lorsque les harraga sont en pleine Mer méditerranée, dans la nuit noire, leurs seules lueurs sont les étoiles», nous explique-t-il.
Sont également présentes des créations de la plasticienne Amina Menia. Née en 1976, cette artiste vit et travaille à Alger. Son travail se présente sous la forme d’une archéologie urbaine aux croisements de l’histoire, de la mémoire des lieux et du langage architectural. Ses œuvres ont été exposées dans de nombreux musées, centres d’art et galeries, parmi lesquels le Centre Pompidou, à Paris, le New Museum of Contemporary Art de New York, le Museum of African Design de Johannesburg, le Musée d’art contemporain de Marseille ou encore le Royal Hibernian Academy de Dublin.

Dessin, peinture, sculpture, installations, photographie, vidéo: Sadek Rahim est quant à lui un artiste pluridisciplinaire. Il a vécu en Syrie et en Jordanie et a été formé à l’École des beaux-arts de Beyrouth. Diplômé du prestigieux Central Saint Martins College of Arts and Design de Londres, il vit et travaille en Algérie depuis 2004 et poursuit sa carrière internationale. Il a notamment exposé aux Émirats arabes unis, en France, en Corée, en Espagne, en Argentine, en Allemagne, en Grande-Bretagne, au Liban, en Slovaquie, en Tunisie, au Maroc, au Sénégal et aux États-Unis.
L’exposition «Quelque part entre le silence et les parlers» est programmée du 26 au 28 novembre 2021 à la Maison des arts de Malakoff, dans les Hauts-de-Seine, en région parisienne.