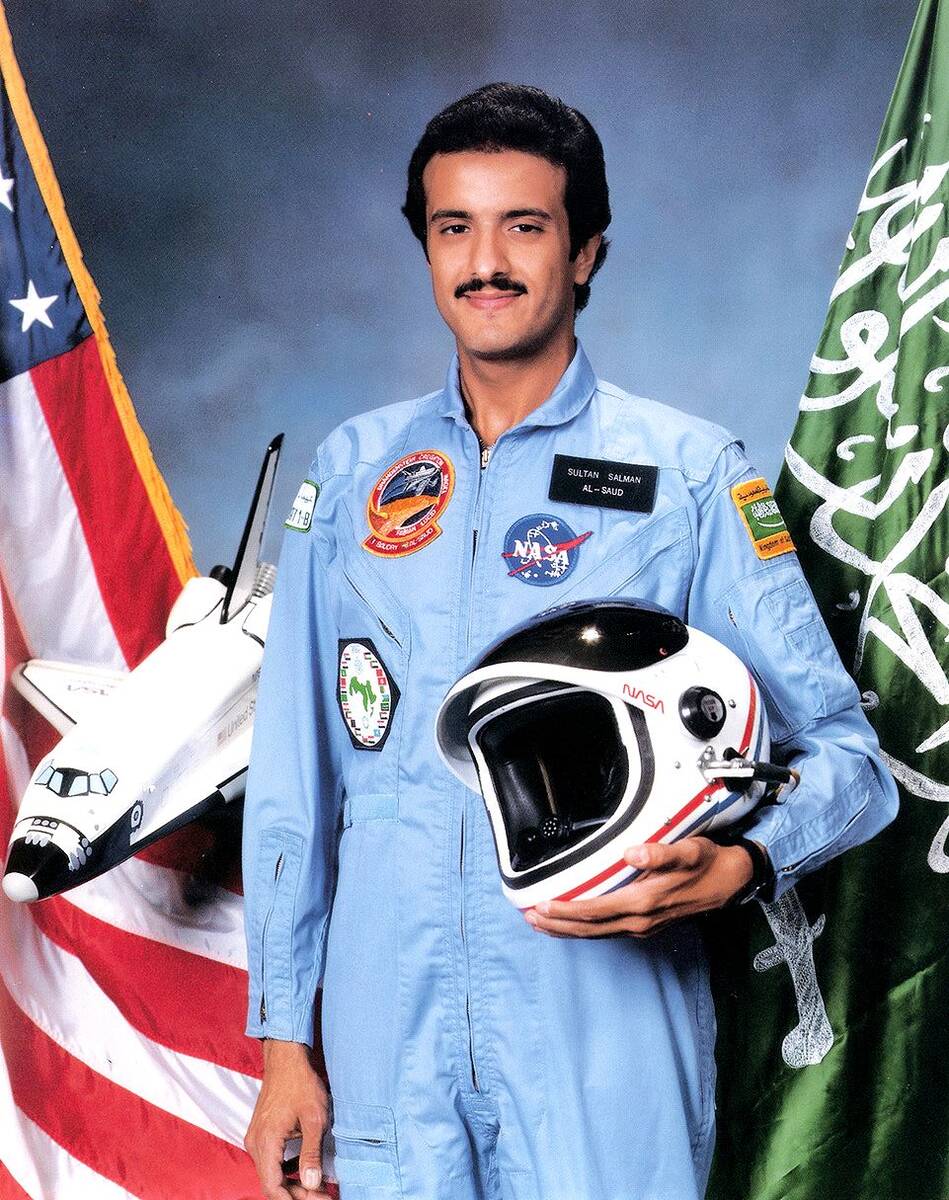ALGER: Il y a vingt ans éclatait le « Printemps noir » en Kabylie, des émeutes nées de la mort d'un lycéen dans une gendarmerie, réprimées dans le sang par le régime. Une révolte au nom de l'identité berbère, pionnière de la contestation dans la rue.
Le 18 avril 2001, Massinissa Guermah, 18 ans, est grièvement blessé par une rafale de kalachnikov dans la gendarmerie de Béni-Douala, un bourg montagneux près de Tizi Ouzou, à l'est d'Alger.
Le lycéen avait été interpellé après une banale altercation entre jeunes et gendarmes. Deux jours après, il meurt dans un hôpital à Alger.
La Kabylie, qui s'apprêtait à célébrer le 21e anniversaire du « Printemps berbère » d'avril 1980 -- des manifestations en faveur de la reconnaissance de la culture berbère -- se soulève après les obsèques du jeune homme.
Un peu partout, les habitants descendent dans les rues des bourgs et des villages pour réclamer la fermeture de toutes les brigades de gendarmerie de la région.
Les manifestations tournent à l'affrontement avec les forces de l'ordre qui tirent à balles réelles. La répression fera 126 morts et plus de 5 000 blessés.
« Réaction de colère »
« Personne ne pouvait imaginer qu'un gendarme pouvait tuer de sang-froid un jeune dans sa brigade », se souvient Saïd Sadi, une des figures emblématiques du mouvement identitaire et culturel berbère.
« La réaction de la population était une réaction de colère », affirme-t-il.
Le « Printemps noir » de 2001 est « l'acte de naissance d'une nouvelle forme de contestation (en Algérie) qui se traduit par l'occupation de la rue », explique Sadi, ex-président du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), un parti d'opposition laïc, issu de la mouvance berbère en février 1989.
Depuis, le recours aux défilés est devenu un marqueur du mécontentement populaire quand il s'agit de transmettre un message aux autorités.
Ainsi, les tensions sociales, comme le problème de l'accès à l'eau potable et les difficultés de logement, donnent souvent lieu à des manifestations qui dégénèrent parfois en émeutes.
En 2011, l'année du « Printemps arabe » au Maghreb et au Moyen-Orient, l'Algérie a enregistré plus de 10 000 mouvements sociaux, rappelle Saïd Sadi.
« La quasi-totalité des revendications n'empruntent jamais le chemin de la légalité », observe-t-il.
Jusqu'au puissant mouvement de protestation populaire du Hirak, qui a obtenu le départ du président Abdelaziz Bouteflika en avril 2019 et qui continue, malgré l'interdiction des rassemblements, d'exiger un changement radical du « système » en place depuis l'indépendance en 1962.
« Crimes d'Etat »
Il y a vingt ans, le chef du RCD, alors membre de la coalition gouvernementale, avait interpellé Bouteflika, élu en 1999 sur la promesse de ramener la paix dans un pays en proie à une sanglante guerre civile avec les islamistes : « On ne peut pas continuer à siéger dans un gouvernement qui tire sur ses enfants ! ».
Au printemps 2002, le mouvement des « aârchs » (tribus kabyles), une organisation ancestrale devenue le fer de lance de la contestation, obtient le départ de la majorité des brigades de gendarmerie de Kabylie.
Le tamazight, la langue berbère, est également reconnu comme « langue nationale » sur décision de Bouteflika, pourtant réfractaire à toute idée de pluralité.
« Il a accordé le statut de langue nationale au tamazight pour se dédouaner de la responsabilité des crimes d'Etat commis en Kabylie », juge aujourd'hui Saïd Sadi, qui vient de publier le deuxième tome de ses mémoires.
Le tamazight a ensuite été consacré deuxième langue officielle du pays avec l'arabe lors d'une révision de la Constitution en 2016.
Autre avancée : en décembre 2017, Bouteflika a décrété Yennayer, le Nouvel An berbère, jour férié en Algérie « pour conforter l'unité nationale ».
Certes, la reconnaissance de la langue berbère n'a rien changé sur le terrain. Car le fait que son enseignement soit resté facultatif l'a reléguée au rang d'accessoire dans les programmes scolaires.
Mais dans la vie d'une nation qui se construit comme l'Algérie, il n'est pas inutile d'avoir des « référents symboliques », relève Sadi, ajoutant qu'il est « important que le Front de libération nationale (FLN), l'ex-parti unique, qui a stigmatisé cette question (identitaire) pendant des décennies ait été acculé à la reconnaître ».