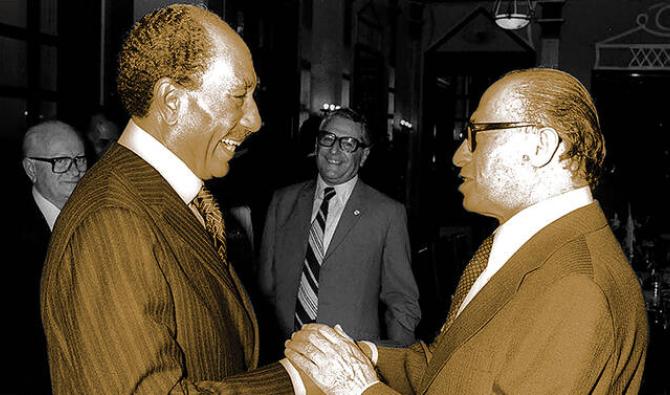AL-MUKALLA : Le gouvernement internationalement reconnu du Yémen et les Houthis n'ont pas réussi à conclure un nouvel accord d'échange de prisonniers, anéantissant les espoirs des familles yéménites de voir leurs proches détenus libérés.
Des responsables des deux parties ont déclaré samedi soir que les discussions menées sous l'égide de l'ONU à Mascate s'étaient achevées sans qu'un accord sur un nouvel échange de prisonniers n'ait été trouvé.
L'envoyé des Nations unies pour le Yémen, Hans Grundberg, a annoncé la fin du dialogue à Mascate, déclarant que les pourparlers avaient abouti à une "avancée significative" lorsque le gouvernement yéménite et les Houthis ont accepté de libérer l'éminent homme politique Mohammed Qahtan, qui constituait un point de discorde entre les deux parties.
Le gouvernement et les milices ont convenu de se rencontrer à nouveau pour approuver les noms des détenus devant être libérés.
"Des milliers de Yéménites attendent de retrouver leurs proches. Malgré les progrès accomplis, il reste encore beaucoup à faire, et plus rapidement, pour soulager les familles qui souffrent", a déclaré M. Grundberg dans un communiqué.
Bien qu'il ait accusé les Houthis de tenter de faire dérailler les négociations sur l'échange de prisonniers, Majed Fadhail, porte-parole de la délégation gouvernementale, a également parlé de "quelques percées" dans les questions concernant les prisonniers de guerre et les personnes disparues de force.
Le gouvernement a convenu avec les Houthis de revenir pour un cycle de négociations "supplémentaire" dans deux mois, a-t-il ajouté.
La semaine dernière, le gouvernement yéménite et M. Grundberg se sont déclarés confiants quant aux progrès des négociations après que les Houthis ont accepté d'échanger M. Qahtan contre 50 de leurs prisonniers, levant ainsi un obstacle majeur aux discussions.
Dans un message publié sur X, Abdulkader Al-Murtada, chef du Comité national des Houthis pour les affaires des prisonniers, a déclaré qu'au cours des discussions, la milice avait réglé son différend avec le gouvernement yéménite au sujet de la libération de M. Qahtan et échangé des noms de prisonniers potentiels à libérer, citant des "contraintes de temps" comme raison de l'arrêt des pourparlers.
Le dernier cycle de négociations sous l'égide de l'ONU entre le gouvernement yéménite et les Houthis a débuté dimanche dernier dans l'espoir de parvenir à un nouvel accord d'échange de prisonniers afin d'alléger les souffrances de centaines de prisonniers de guerre et de civils enlevés.
Ces négociations interviennent alors que le gouvernement yéménite a accusé les Houthis d'avoir attaqué le domicile à Sanaa d'Ahmed Ahmed Ghaleb, le gouverneur de la banque centrale du Yémen à Aden.
Le domicile du gouverneur de la banque centrale saccagé
Selon l'agence de presse officielle, des combattants houthis armés ont pris d'assaut la résidence de M. Ghaleb à Sanaa et ont fait sortir les personnes qui s'y trouvaient, apparemment en réponse aux récentes actions du gouverneur contre les institutions bancaires de Sanaa.
M. Ghaleb a récemment sanctionné de nombreuses banques pour avoir refusé de transférer leurs bureaux de Sanaa, contrôlée par les Houthis, à Aden, contrôlée par le gouvernement.
Il a également ordonné le retrait des billets de banque imprimés avant 2016 et largement utilisés dans le territoire houthi.
Depuis qu'ils ont pris le pouvoir au Yémen il y a plus de dix ans, les Houthis ont saisi les maisons et autres biens de centaines de politiciens yéménites, de journalistes, de défenseurs des droits de l'homme, de militaires et de membres des forces de sécurité, d'avocats et d'autres personnes qui ont contesté leurs politiques rigoureuses.
Par ailleurs, le ministère yéménite des dotations et de l'orientation a déclaré samedi que tous les pèlerins yéménites bloqués étaient rentrés chez eux après que les Houthis eurent autorisé un avion de Yemenia Airways à les transporter de Jeddah à Sanaa.
Des centaines de pèlerins yéménites ont été bloqués en Arabie saoudite lorsque les Houthis ont saisi trois avions de Yemenia à l'aéroport de Sanaa et les ont empêchés de se rendre en Arabie saoudite pour ramener les pèlerins.
Un responsable du gouvernement yéménite a déclaré à Arab News que l'impasse avec les Houthis concernant la capture des avions de Yemenia n'était pas terminée et que les Houthis s'étaient à nouveau emparés de l'avion de Yemenia qui transportait les pèlerins et avaient refusé toutes les médiations pour libérer l'avion.
Les Houthis affirment qu'ils vont administrer Yemenia Airways, réparer l'avion et réorganiser les vols à partir des aéroports yéménites, y compris ceux détenus par le gouvernement.
Le gouvernement yéménite a accusé les Houthis de "détourner" les vols et d'aggraver l'agonie des Yéménites qui ne peuvent plus voyager en raison de la saisie des avions.