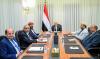ALGER: Le 3 juillet 2020, Paris restituait officiellement à l’Algérie vingt-quatre crânes entreposés au musée de l’Homme de Paris et datant de la conquête française, au XIXe siècle. Il s’agissait de la concrétisation d’une promesse formulée en décembre 2017 par le président français, Emmanuel Macron, en réponse à «une demande à maintes reprises réitérée par les autorités algériennes».
Le processus de restitution avait donné lieu à un long travail d’enquête entrepris à partir de 2018 par une commission mixte d’experts algériens et français, puis abouti à la remise des crânes aux autorités d’Alger. Les vingt-quatre restes humains rendus, ils ont été inhumés, le dimanche 5 juillet 2020, lors d’une cérémonie officielle au carré des martyrs du cimetière d’El-Alia, à Alger, où reposent les héros de la révolution algérienne.
L’affaire a rebondi voici quelques semaines. Le prestigieux New York Times révélait le 17 octobre dernier que, parmi les vingt-quatre restes humains rendus, seuls six pouvaient être considérés avec certitude comme étant ceux de résistants algériens morts – et décapités – lors de la colonisation. Dans les rebondissements de cette affaire, des médias indiquent que ce sont vingt-six crânes, et non vingt-quatre, qui devaient initialement être restitués. Deux d’entre eux ne l’ont finalement pas été en 2020.
Ces deux crânes ne pouvaient pas être restitués dans la mesure où ils ne faisaient pas partie de la collection nationale conservée au musée de l’Homme de Paris, mais appartenaient à la Société d’anthropologie de Paris (SAP).
Pour l'historien Mohamed Belghith, «l'identification des restes mortuaires des résistants est un processus long et difficile qui implique la coordination de plusieurs disciplines et spécialistes en la matière, soit des historiens, des anthropologues, médecins et gérontologues».
Anthropologue, historien et auteur notamment de Boubaghla, le sultan à la mule grise: la résistance des Chorfas, Ali Farid Belkadi a été à l’origine de la découverte, en 2011, des crânes de résistants algériens au Musée national d'histoire naturelle (MNHN) à Paris, dont celui de Chérif Boubaghla, à qui il a d’ailleurs consacré le livre cité précédemment. Il indique qu'il a proposé au ministère de la Culture algérienne «l’inventaire des stèles phéniciennes de Cirta-Constantine que j’ai dressé en plusieurs jours, dans les réserves du Musée du Louvre: aucune réponse».
De la passivité des autorités algériennes à la ruse des Français, nostalgiques de leur passé colonial, Dr Belkadi veut attirer l'attention sur «un nombre incalculable d’événements marquants dans la longue lutte des Algériens contre le joug colonial qui sont ignorés jusqu’à nos jours», précise-t-il.
«Vol d'un pan entier de l'histoire algérienne»
Pour l'anthropologue, «la colonisation est un déluge qui a tout submergé sur son passage, ne laissant survivre que des illettrés et des ignorants». Il n'y a pas que les restes des résistants qui «provoquent l'émotion» de l'historien. Souvenons-nous du 5 juillet 1962, date de l'indépendance de l'Algérie, au cours de laquelle des conteneurs entiers de livres rares et des manuscrits inestimables de la Bibliothèque universitaire d’Alger ont été transférés en France alors que celle-ci avait été incendiée par l’Organisation de l’armée secrète (OAS), le 7 juin 1962. Sur les six cent mille ouvrages que la bibliothèque comptait, «seuls quatre-vingt mille ont pu être sauvés». Il s'agit selon l'anthropologue de vols de pans entiers de l'Histoire de ce pays.
En effet, la liste des restes mortuaires devant encore être restitués n’est pas close. Des médias révèlent que les premières investigations entreprises au musée de l’Homme avaient en effet permis de répertorier quarante-quatre crânes d’Algériens probablement morts dans le courant du XIXe siècle. Plus tard, des recherches plus minutieuses ont permis d’établir avec certitude que vingt-six de ces crânes dataient bien de cette période et pouvaient donc être rendus.
L'historien qualifie de «transcendante» l'affaire des crânes de résistants, et il insiste pour que la chaîne des événements ne soit pas interrompue. «La guerre d’indépendance de 1954-1962 ne doit pas être dissociée de l’Histoire des nombreux mouvements de résistance qui se sont opposés à la France dès 1830.» Le plus souvent, lorsqu’on évoque les soulèvements dans l’Algérie coloniale, note Dr Belkadi, «on se limite à la résistance de l'émir Abdelkader dans l’ouest jusqu’en 1847 et à la révolte tardive du cheikh El-Haddad en Kabylie en 1871. Sans omettre les soulèvements locaux, comme l’insurrection des Righas à Aïn Torki (ex-Marguerite) de Yacoub Mohammed ben el-hadj Ahmed.
«Ces révoltes survenaient comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Un siècle avant les maquis de la guerre d’indépendance, et avant l’apparition du cheikh El-Haddad, les populations des régions de Sétif, Bejaïa ou de la vallée de la Soummam, en Kabylie, s’étaient soulevées contre le joug colonial des Français. Khedoudja bent Ahmed Benkanoun des Issers est une héroïne au moins égale à Fatma N’Soumer. Une haute et belle figure de la résistance. Lors de l'insurrection de 1871, elle lutta les armes à la main contre les occupants français, elle était affiliée à la Rahmania et n'obéissait qu'au cheikh El-Haddad.»
Réaction officielle timide
Les autorités algériennes ont répondu à ces révélations. Le ministre des Moudjahidines (anciens combattants) a démenti les informations rapportées par le journal américain, en les qualifiant de «fausses et infondées».
Laïd Rebiga a affirmé que «les vingt-quatre crânes ont été clairement identifiés, de manière scientifique et suivant les normes mondiales, comme étant des restes mortuaires de résistants algériens, et ce, bien avant leur restitution à l’Algérie».
Dr Belkadi voit dans cette polémique un autre indice révélateur du «gouffre» séparant les Algériens de leur Histoire. «L’Histoire, ce n’est pas tout blanc ou tout noir. Il n’y a pas de recette pour écrire l’Histoire. Il faudrait régulièrement élargir les champs de la recherche et ne pas se contenter de ce que l’on a sous les yeux. De nos jours, on peut avoir accès en un clin d’œil à des sources documentaires insoupçonnées auparavant, grâce aux technologies numériques», explique-t-il. Et d'ajouter: «Il faut libérer tous les possibles pour les nouvelles générations, transmettre le flambeau qui illuminera les idées saines.»
Côté officiel, le discours des autorités publiques reste toujours du côté de la dénonciation de «l’acharnement médiatique contre l’Algérie». Laïd Rebiga déclare d’ailleurs à ce propos: «C’est l’Algérie qui est ciblée par cette campagne médiatique mensongère.» Il s’engage à dévoiler plus de détails au sujet de cette affaire prochainement.