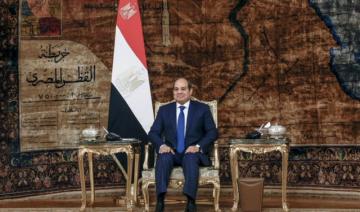WASHINGTON : Un an après les images inouïes de partisans de Donald Trump envahissant le Capitole, les Américains peinent toujours à prendre la pleine mesure de cette attaque sans précédent contre leur démocratie.
La violence de cet assaut, qui a choqué les États-Unis et terni leur image dans le monde, est immortalisée dans les nombreuses vidéos prises le 6 janvier 2021.
Des assaillants frappent des policiers avec des barres de fer, un agent écrasé sur le pas d'une porte hurle de douleur, des émeutiers en tenue de combat scandent «Pendez Mike Pence» tandis que le vice-président s'enfuit, une femme est abattue par la police dans les couloirs du Congrès.
«Même pendant la Guerre civile, les insurgés n'avaient pas violé l'enceinte de notre Capitole, la citadelle de notre démocratie», a relevé le président Joe Biden en juillet. «Cela a provoqué une crise existentielle et un test pour savoir si notre démocratie pouvait survivre».
Pour le premier anniversaire de l'attaque, les démocrates du Congrès ont donc prévu des commémorations «solennelles», censées donner une perspective historique aux événements.
Mais Donald Trump a choisi, lui, un ton défiant: il compte répéter, lors d'une conférence de presse en Floride, que la présidentielle de novembre 2020 lui a été volée.
Bien qu'aucune preuve ne vienne appuyer ses propos, au coeur de l'assaut sur le siège du Congrès, des sondages montrent qu'environ deux tiers des électeurs républicains le croient.
Et les élus républicains, bien conscients que le milliardaire reste le faiseur de rois dans leur camp, se sont presque tous rangés derrière lui. Car le parti veut reprendre le pouvoir lors des élections de mi-mandat de 2022. En 2024, Donald Trump pourrait même briguer un nouveau mandat.
- Tentatives concertées –
En un an, le déroulement des événements est devenu plus clair.
Bien avant le scrutin, l'impétueux président dénonçait déjà des «fraudes massives» et faisait savoir qu'il n'accepterait pas la défaite.
Lorsque la victoire de son rival fut établie, ses partisans et lui ont tenté d'invalider le dépouillement dans des États-clés à coups de plaintes et de pressions sur des dirigeants locaux.
Quand toutes ces tentatives ont échoué, ils ont reporté leurs efforts sur le 6 janvier. Ce jour-là, le vice-président Mike Pence devait convoquer les deux chambres du Congrès pour certifier la victoire de Joe Biden.
Donald Trump avait alors appelé ses partisans à une «grande manifestation à Washington». «Soyez-y, ça va être énorme!», avait-il tweeté.
En même temps, la pression montait sur Mike Pence pour qu'il stoppe la certification des résultats, sur la base de justifications légales douteuses qu'ont fait circuler des alliés du président, son chef de cabinet Mark Meadows et des élus républicains.
Tous ces éléments ont fusionné le Jour J.
Tandis que le Congrès se préparait à se réunir, Donald Trump haranguait ses partisans devant la Maison Blanche, martelant que l'élection lui avait été «volée».
«Si Mike Pence fait ce qu'il faut faire, nous gagnons l'élection», avait-il ajouté à l'adresse de son numéro deux, avant d'inviter ses supporteurs à aller au Congrès «se battre comme des diables».
- Combats -
Des milliers de personnes s'étaient alors dirigées vers le Capitole, dont des membres de groupes d'extrême droite comme les Proud Boys, certains en tenue de combat, avec des casques et des gilets pare-balles.
Dans un hôtel tout près de là, des alliés de Donald Trump réunissaient une «cellule de crise», aujourd'hui soupçonnée d'avoir fait le lien entre les manifestants, le Bureau ovale et des élus républicains.
Débordés, les policiers du Capitole n'avaient pas réussi à contenir les foules. Face au chaos, la session avait été suspendue, des élus avaient fui, d'autres s'étaient cachés dans des bureaux fermés.
Il a fallu plus de six heures à la police et aux renforts fédéraux pour reprendre le contrôle des lieux.
Finalement, c'est aux premières heures du 7 janvier que le Congrès a officialisé la victoire de Joe Biden.
Cinq personnes sont mortes pendant l'assaut, dans des circonstances confuses. Des dizaines ont été blessées.
Depuis, plus de 720 personnes ont été inculpées pour avoir participé à ce coup de force. De premières peines ont été prononcées, dont une de cinq ans de prison pour un homme qui avait agressé des policiers.
- Course contre la montre -
Mais les Américains attendent toujours que les responsables politiques rendent des comptes.
Juste après l'attaque, Donald Trump a bien fait l'objet d'un procès en destitution au Congrès. Il a toutefois été acquitté très rapidement grâce aux sénateurs républicains.
Les démocrates ne veulent pas en rester là. Fort de leur majorité à la Chambre des représentants, ils ont mis en place une commission d'enquête pour faire toute la lumière sur son rôle le 6 janvier.
Une de ses membres, Liz Cheney, rare républicaine à soutenir les investigations, a clairement dit que Donald Trump était dans la ligne de mire.
«Jamais dans l'histoire de notre pays une enquête parlementaire sur les actions d'un ancien président n'a été aussi justifiée», a-t-elle déclaré. «Nous ne pouvons pas céder face aux tentatives du président Trump de cacher ce qui s'est passé».
La commission a jusqu'ici interrogé près de 300 personnes mais elle se heurte au refus de coopérer des proches de l'ancien président. Et le temps joue contre elle: si les républicains reprennent le contrôle de la Chambre lors des élections de novembre 2022, ils pourraient mettre fin à ses travaux.
Or, pour William Galston, politologue à l'institut Brookings, «le 6 janvier était le signe avant-coureur d'un danger clair et actuel».
Certes, «la tentative d'invalider les résultats d'une élection démocratique a échoué», affirme-t-il.
Mais «cela sera-t-il le cas dans trois ans? Ce n'est pas si évident. Parce que les personnes qui étaient déterminées à invalider les suites de l'élection de 2020 ont beaucoup appris».
«Une journée incroyable»: trois trumpistes revivent l'assaut du Capitole
Ils se sont rendus par milliers à Washington le 6 janvier 2021 pour protester contre une élection présidentielle qu'ils croient encore truquée. Le Capitole a été pris d'assaut, le pays meurtri.
Un an plus tard, trois manifestants retracent cette journée qui a choqué le monde.
- «Euphorie» -
"C'était une journée incroyable", se remémore Samson Racioppi, 40 ans, encarté au parti républicain. Le 6 janvier, cet homme se charge d'affréter une série de bus de son État du Massachusetts direction la capitale, Washington.
Une marée humaine y est réunie dans un froid glacial, agitant des drapeaux "Trump 2020" pour dénoncer le résultat de l'élection présidentielle qui a vu perdre le milliardaire républicain. Le président se présente sur une estrade. La foule est galvanisée.
"Je me souviens de ce sentiment d'euphorie, voir tout autour de nous ces gens qui enfin, en avaient quelque chose à faire", raconte Jim Wood, venu tout droit de l'État du New Hampshire.
Avant que Donald Trump ne finisse de parler, ce sexagénaire se fraye un chemin et suit un cortège en route vers le Congrès américain où, à leur grand dam, des élus sont en train de certifier la victoire de Joe Biden.
Des milliers de manifestants l'imitent. En quelques instants, une foule se masse devant le dôme blanc du Capitole.
- «L'anarchie» -
"Et puis soudain, on entend des cris, des +on y va, on y va+", s'exclame Glen Montfalcone, venu du Massachusetts. "C'est là que l'anarchie a commencé."
"Les gens poussaient, poussaient, poussaient en criant "Avancez!", confie-t-il. "Et donc c'est ce que nous avons fait, on a foncé."
Sont-ils rentrés dans le Capitole? Tous les trois jurent que non. Mais dire le contraire, c'est aussi risquer la prison.
Un homme torse-nu avec des cornes de bison déambulant dans l'enceinte du Capitole, une manifestante tuée par la police... Avec stupeur, le monde entier suit en direct l'invasion du Congrès américain.
Ces images, Jim Wood dit les découvrir le lendemain, au petit-déjeuner. "Une diabolisation!", fustige-t-il, assurant que l'immense majorité des manifestants sont restés à l'extérieur du bâtiment.
Au cours des mois suivants, deux récits de cette journée du 6 janvier s'opposent.
Les policiers en fonction ce jour-là, des élus démocrates et même certains républicains qualifient ces actes de "terroristes".
- Le FBI à la porte -
Des opérations de police sont lancées aux quatre coins du pays. Glen Montfalcone voit plusieurs agents du FBI débarquer à sa porte, ses amis se font arrêter.
Dans sa fac de droit, des camarades de Samson Racioppi se mobilisent pour qu'il soit renvoyé. Sans succès.
A Washington, une commission parlementaire est mise sur pied pour enquêter sur la possibilité que les manœuvres du camp Trump aient pu constituer une tentative de coup d'État.
Un coup d’État ? Les manifestants du Capitole s'insurgent contre cette expression. Ils gardent au contraire le souvenir d'une journée exaltante, qui donne la chair de poule, "quelque chose que je raconterai à mes petits-enfants", promet Samson Racioppi.
Toujours persuadé, comme la majorité des électeurs républicains que l'élection de 2020 a été volée - malgré les innombrables preuves du contraire - il se dit prêt à défendre les prochains scrutins coûte que coûte.
"Nous voyons cela comme une guerre", affirme l'étudiant en droit. "Nous allons lancer une série de batailles et causer autant de dégâts que possible à la gauche et à ceux qui soutiennent la tyrannie."
Jusqu'à retourner au Capitole? "Bien évidemment."