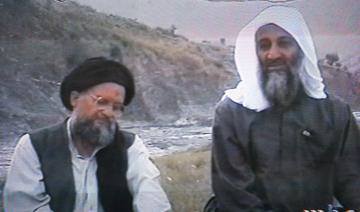Kaboul : La direction des talibans, qui se préparent à former un gouvernement en Afghanistan dès que les troupes américaines et étrangères en seront parties mardi, a toujours été entourée de mystère, y compris lorsque le mouvement dirigeait le pays entre 1996 et 2001.
Voici une brève présentation des principaux dirigeants du groupe islamiste, qui a reconquis le pouvoir le 15 août, 20 ans après en avoir été chassé par une coalition menée par les États-Unis.
Hibatullah Akhundzada, le leader suprême

Le mollah Hibatullah Akhundzada a été nommé à la tête des talibans en mai 2016, quelques jours après la mort de son prédécesseur, Mansour, tué par une frappe de drone américain au Pakistan.
Avant sa nomination, Akhundzada était relativement inconnu, plus impliqué dans les questions judiciaires et religieuses que dans les manœuvres militaires.
Une fois arrivé au pouvoir, Akhundzada a rapidement obtenu la loyauté de l’Égyptien Ayman al-Zawahiri, le chef d'Al-Qaïda, qui l'a qualifié d'"émir des croyants", renforçant ainsi sa crédibilité dans l'univers jihadiste.
Fils d'un théologien, originaire de Kandahar, cœur du pays pachtoune dans le Sud de l'Afghanistan et berceau des talibans, cet érudit jouissait déjà d'une grande influence au sein de l'insurrection, dont il dirigeait le système judiciaire. Son rôle à la tête du mouvement serait davantage symbolique qu'opérationnel, selon plusieurs analystes.
Akhundzada a dû avant tout unifier les talibans, une mission complexe tant ceux-ci s'étaient fracturés dans une violente lutte pour le pouvoir après la mort de Mansour et la révélation qu'ils avaient caché pendant des années celle du fondateur du mouvement, le mollah Omar.
Il a réussi à maintenir la cohésion du groupe et reste plutôt discret. Il ne diffuse que de rares messages annuels lors des fêtes islamiques.
Après avoir longtemps gardé le silence sur l'endroit où il se trouvait, son mouvement a indiqué dimanche qu'il vivait "depuis le début" à Kandahar et qu'il apparaîtrait "bientôt en public".
Le mollah Baradar, le cofondateur

Abdul Ghani Baradar, né dans la province d'Uruzgan et qui a grandi à Kandahar, est le cofondateur des talibans avec le mollah Omar, décédé en 2013 mais dont la mort avait été cachée deux années durant.
Comme nombre d'Afghans, sa vie a été bouleversée par l'invasion soviétique en 1979, qui en a fait un moudjahid. On pense qu'il a combattu aux côtés du mollah Omar, qui était borgne.
Tous deux auraient fondé les talibans durant la guerre civile afghane du début des années 1990, quand des chefs de guerre mettaient le pays à feu et à sang.
En 2001, après l'intervention américaine et la chute du régime taliban, il aurait fait partie d'un petit groupe d'insurgés prêts à un accord dans lequel ils reconnaissaient la nouvelle administration de Kaboul. Mais les États-Unis ont rejeté cette initiative, ouvrant un nouveau chapitre de vingt années de guerre.
Baradar était le chef militaire des talibans quand il a été arrêté en 2010 à Karachi, au Pakistan. Il a été libéré en 2018, sous la pression de Washington.
Écouté et respecté des différentes factions talibanes, il a ensuite été nommé chef de leur bureau politique, basé au Qatar.
Il a conduit les négociations de Doha avec les Américains menant au retrait des forces étrangères d'Afghanistan, puis aux pourparlers de paix avec le gouvernement afghan, qui n'ont rien donné.
Il est rentré en Afghanistan, à Kandahar, deux jours après la prise du pouvoir par les talibans, puis est allé à Kaboul.
Sirajuddin Haqqani, le chef du réseau Haqqani

Fils d'un célèbre commandant du jihad anti-soviétique, Jalaluddin Haqqani, Sirajuddin est à la fois l'un des trois chefs adjoints des talibans et le chef du puissant réseau éponyme.
Le réseau Haqqani, fondé par son père, est qualifié de terroriste par Washington, qui l'a toujours considéré comme l'une des plus dangereuses factions combattant les troupes américaines et de l'Otan ces deux dernières décennies en Afghanistan.
Le réseau est connu pour son recours à des kamikazes. On lui a attribué certaines des attaques les plus violentes perpétrées en Afghanistan ces dernières années.
Il a aussi été accusé d'avoir assassiné certains hauts responsables afghans et d'avoir retenu en otage des Occidentaux, avant de les libérer contre rançon ou des prisonniers, comme le soldat américain Bowe Bergdahl, relâché en 2014 en échange de cinq détenus afghans de la prison de Guantanamo.
Connus pour leur indépendance, leur habileté au combat et leur sens des affaires, les Haqqani sont en charge des opérations talibanes dans les zones montagneuses de l'Est afghan. Ils auraient une forte influence sur les décisions du mouvement.
Le mollah Yaqoub, l'héritier
Fils du mollah Omar, Yaqoub est le chef de la puissante commission militaire des talibans qui décidait des orientations stratégiques dans la guerre contre le gouvernement afghan.
Son ascendance et ses liens avec son père, qui faisait l'objet d'un véritable culte en tant que chef des talibans, en font une figure unificatrice au sein d'un mouvement large et diverse.
Les spéculations sur son rôle exact dans le mouvement sont toutefois persistantes. Certains analystes estiment que sa nomination à la tête de cette commission en 2020 n'était que purement symbolique.
Les «étudiants en religion»
KABOUL : Quinze jours après avoir pris le contrôle de Kaboul à l'issue d'une offensive militaire éclair, les talibans ont célébré dans la nuit de lundi à mardi le retrait des dernières troupes américaines qui étaient présentes depuis vingt ans en Afghanistan.
Le mouvement islamiste radical, qui avait déjà gouverné le pays de 1996 à 2001 en imposant une interprétation radicale de la charia, a promis cette fois-ci la paix et un gouvernement "inclusif".
Retour sur les événements marquants de l'histoire du mouvement taliban fondé en 1994 :
Etudiants en religion
En 1994, le mouvement des talibans ("étudiants en religion") apparaît en Afghanistan dans un pays dévasté par la guerre contre les Soviétiques (1979-89) et confronté à une lutte fratricide entre moudjahidines depuis la chute en 1992 du régime communiste à Kaboul.
Formés dans des madrassas (écoles coraniques) au Pakistan voisin où ces islamistes sunnites ont trouvé refuge durant le conflit avec les Soviétiques, les talibans ont alors à leur tête le mystérieux mollah Mohammad Omar, décédé en 2003. Le mollah Akhtar Mansour lui succèdera et sera tué en 2016 au Pakistan. Les talibans sont aujourd'hui dirigés par Haibatullah Akhundzada, alors que le mollah Abdul Ghani Baradar, co-fondateur du mouvement, dirige l'aile politique.
Comme la majorité de la population afghane, ils sont essentiellement Pachtounes, l'ethnie qui a dominé le pays quasi-continuellement depuis deux siècles.
Ascension fulgurante
Promettant de rétablir l'ordre et la justice, les talibans connaissent une ascension fulgurante, avec le soutien du Pakistan et l'approbation tacite des Etats-Unis.
En octobre 1994, ils prennent presque sans combat Kandahar, l'ancienne capitale royale.
Dotés d'un arsenal militaire et d'un important trésor de guerre qui leur permet d'acheter les commandants locaux, ils enchaînent les conquêtes territoriales jusqu'à Kaboul dont ils s'emparent le 27 septembre 1996.
Ils chassent le président Burhanuddin Rabbani et exécutent en public l'ex-président communiste Najibullah.
Le commandant Ahmed Shah Massoud, héros de la résistance antisoviétique, se replie dans la vallée du Panchir, au nord de Kaboul, où il organise l'opposition armée. Il sera assassiné par le réseau islamiste Al-Qaïda le 9 septembre 2001.
Régime de terreur
Au pouvoir, les talibans imposent la loi islamique la plus stricte, interdisant jeux, musique, photographies, télévision... Les femmes n'ont plus le droit de travailler et les écoles pour filles sont fermées.
Mains des voleurs coupées, meurtriers exécutés en public, homosexuels écrasés sous un mur de briques, femmes adultères lapidées à mort: leurs châtiments sont dénoncés et le dynamitage en mars 2001 des bouddhas géants de Bamiyan provoque un tollé international.
Le siège du pouvoir se déplace à Kandahar où le mollah Omar vit reclus dans une maison construite par le chef d'Al-Qaïda Oussama ben Laden.
Le territoire des talibans (qui contrôleront jusqu'à 90% de l'Afghanistan) devient un sanctuaire pour les jihadistes du monde entier qui s'y entraînent, notamment Al-Qaïda.
Capitulation
Après les attentats du 11-Septembre aux Etats-Unis, perpétrés par Al-Qaïda, Washington et ses alliés de l'Otan lancent le 7 octobre 2001 une vaste opération militaire suite au refus du régime taliban de livrer ben Laden.
Le 6 décembre, le régime capitule. Ses chefs s'enfuient avec ceux d'Al-Qaïda, dans le Sud et l'Est du pays mais aussi au Pakistan.
Rébellion sanglante
Attentats et embuscades se multiplient contre les forces armées occidentales.
La Mission de combat de la Force internationale d'assistance à la sécurité (FIAS) de l'Otan, terminée fin 2014, est remplacée par celle de formation, conseil et assistance, baptisée Resolute Support. Les forces de sécurité afghanes combattent seules contre les talibans et autres groupes insurgés, soutenues par l'aviation américaine.
En juillet 2015, le Pakistan accueille les premiers pourparlers directs, soutenus par Washington et Pékin, entre Kaboul et les talibans. Le dialogue tourne court.
Parallèlement, la branche afghane du groupe Etat islamique, rivale des talibans, est créée et revendique une série d'attentats sanglants.
Accord historique
Mi-2018, Américains et talibans entament de discrètes négociations à Doha, plusieurs fois interrompues après des attaques contre des troupes américaines.
Le 29 février 2020, Washington signe un accord historique avec les talibans, prévoyant le retrait des soldats étrangers en échange de garanties sécuritaires et de l'ouverture de négociations entre les insurgés et Kaboul.
Retrait américain et offensive talibane
Le 8 juillet 2021, le président américain Joe Biden déclare que le retrait de ses forces, entamé en mai, sera "achevé le 31 août".
Les talibans, à l'offensive depuis mai, arrivent le 15 août aux portes de Kaboul, après avoir pris le contrôle de quasiment tout le pays sans rencontrer de grande résistance. Le gouvernement afghan promet une transition pacifique.
Le 29 août, les talibans annoncent que leur chef suprême Hibatullah Akhundzada se trouve dans la ville de Kandahar et qu'il apparaîtra "bientôt en public".
Dans la nuit du 30 au 31 août, le dernier avion de transport militaire américain décolle de l'aéroport de Kaboul. "Nous avons fait l'histoire", se réjouit Anas Haqqani, un responsable du mouvement islamiste. "Les vingt années d'occupation de l'Afghanistan par les Etats-Unis et l'Otan se sont achevées ce soir".