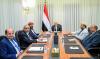PARIS: Joe Biden, qui rencontrera pour la première fois Vladimir Poutine mercredi, affiche depuis son élection une grande fermeté vis-à-vis de son homologue russe, donnant lieu à des échanges mordants.
«Rhétorique très agressive»
"J'ai clairement dit au président Poutine, d'une façon très différente de mon prédécesseur (Donald Trump, ndlr), que le temps où les Etats-Unis se soumettaient aux actes agressifs de la Russie (...) était révolu", avertit Joe Biden le 5 février.
Il cite l'interférence russe dans les élections américaines, les cyberattaques ou encore "l'empoisonnement de citoyens", en référence à l'opposant politique Alexeï Navalny.
"Nous n'hésiterons pas à faire payer à la Russie un coût plus élevé et à défendre nos intérêts".
Le lendemain, le porte-parole de la présidence russe réplique: "C'est une rhétorique très agressive et pas constructive, nous le regrettons".
Entre présidents américains et maîtres du Kremlin, des sommets et des bas
PARIS: Du face-à-face polaire au "nouveau départ", retour sur quelques sommets illustrant quatre décennies de relations parfois tumultueuses entre présidents américains et maîtres du Kremlin.
Eisenhower-Khrouchtchev: un Soviétique chez les Américains
En septembre 1959, Nikita Khrouchtchev effectue, à l'invitation du président américain Dwight Eisenhower, la première visite aux Etats-Unis d'un secrétaire général du Parti communiste soviétique.
Venu en famille, "Monsieur K" enchaîne les déplacements, sautant des champs de maïs de l'Iowa au soleil de la Californie où le tout-Hollywood - Marylin Monroe et Elizabeth Taylor en tête - se presse au déjeuner de 400 couverts donné en son honneur. Devant micros et caméras, le bouillant dirigeant s'offusquera de s'être vu refuser l'entrée de... Disneyland.
A l'issue des entretiens à Camp David, résidence de campagne des présidents américains, les deux super-grands affirment leur volonté d'oeuvrer pour un désarmement général et annoncent la reprise des négociations sur le statut de Berlin que la Guerre froide a séparé en deux camps.
Kennedy-Khrouchtchev: face à la Guerre froide
Les 3 et 4 juin 1961 à Vienne, John Fitzgerald Kennedy, jeune président à peine élu, est confronté au roué Nikita Khrouchtchev.
Le locataire de la Maison Blanche se présente affaibli par l'échec retentissant en avril d'une tentative d'invasion à Cuba, dans la Baie des cochons, soutenue par la CIA.
Deux mois après, le Mur de Berlin est érigé et, en octobre 1962, éclate la crise des missiles déployés par l'URSS à Cuba. Le monde frôle alors la guerre nucléaire. L'épisode, clos par un retrait des missiles soviétiques, débouche sur l'installation en 1963, d'un "téléphone rouge" (à l'époque un simple télex), pour permettre aux dirigeants des deux superpuissances de communiquer directement.
Brejnev-Nixon: une ère de détente
Du 22 au 30 mai 1972, l'ombre de la guerre du Vietnam plane sur le sommet réunissant à Moscou Richard Nixon et le dirigeant soviétique Leonid Brejnev. Quelques jours avant ce voyage, le premier d'un président américain en URSS, Nixon a ordonné des bombardements massifs sur Hanoï.
Cette rencontre a néanmoins inauguré une ère de "détente" entre les États-Unis et l'URSS avec la signature des traités ABM de défense antimissiles et SALT-1 limitant les armements stratégiques. Les deux dirigeants affirmeront notamment qu'"à l'âge nucléaire, la coexistence pacifique est la seule base pour le développement des relations mutuelles".
Nixon et Brejnev se sont rencontrés à deux autres reprises, en 1973 à Washington et 1974 à Moscou, pour consolider la détente. Une période qui s'achève en 1979, avec l'entrée des chars soviétiques en Afghanistan.
Reagan-Gorbatchev: un «nouveau départ»
Du 19 au 21 novembre 1985, Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev renouent à Genève le dialogue soviéto-américain après six ans de gel et trois crises - Afghanistan, Pologne et euromissiles de l'OTAN.
Le nouveau chef réformateur du Kremlin promeut la détente. Le conservateur américain met en sourdine ses sorties sur l'Union soviétique "Empire du Mal". En dépit de l'opposition soviétique au programme de défense antimissiles américain "guerre des étoiles", le sommet est salué par "les deux grands communicateurs" comme "un nouveau départ".
En décembre 1987, la troisième des quatre rencontres Reagan-Gorbatchev aboutit à la signature à Washington du traité historique sur l'élimination des forces nucléaires à portée intermédiaire (INF).
Bush-Eltsine: un duo d'«amis»
Les 1er et 2 février 1992, c'est en "ami" que le président russe Boris Eltsine est accueilli par son homologue américain George Bush, lors de sa première visite aux Etats-Unis depuis la dissolution de l'URSS, fin 1991.
Le sommet, largement informel, se tient à Camp David. Juste avant, le Conseil de sécurité de l'ONU a consacré la Russie comme successeur de l'Union soviétique dans cette instance.
En juin, les deux chefs d'Etat scelleront leur rapprochement en mettant sur les rails un accord de désarmement nucléaire stratégique destiné à approfondir le traité START I signé par Bush et Gorbatchev en 1991. La guerre froide aux oubliettes, les deux pays se trouvent au "seuil d'un nouveau monde", selon le président américain.
Clinton-Eltsine: un fou-rire mémorable
Entre l'arrivée à la Maison Banche en janvier 1993 du démocrate Bill Clinton et la démission de Boris Eltsine du Kremlin le 31 décembre 1999, les deux présidents auront, au delà de multiples désaccords, tissé d'étroites relations au fil de huit sommets américano-russes.
En témoigne une scène complice le 23 octobre 1995, en clôture du sommet de Hyde Park, près de New York. Les discussions n'ont permis aucune percée sur les points de tension du moment - guerre en Tchétchénie ou bombardements de l'OTAN en Bosnie - mais Eltsine veut assurer que ce sommet a déjoué les pronostics les plus sombres.
D'une voix tonitruante, il lance aux journalistes: "vous aviez dit que notre rencontre serait un désastre, mais je vous dis que le désastre, c'est vous qui l'avez subi". Bill Clinton est alors secoué par un fou rire monumental, sous le regard goguenard de son homologue russe, visiblement très content de l'effet produit.
Poutine est un «tueur»
Lors d'un entretien télévisé, Joe Biden provoque la première crise diplomatique de son mandat.
- "Pensez-vous que (Vladimir Poutine) est un tueur?, lui demande le journaliste.
- Oui, je le pense", répond-il, sans préciser s'il fait référence à Alexeï Navalny. "Vous verrez bientôt le prix qu'il va payer".
Interrogé sur les ingérences électorales de Moscou en 2016 et en 2020, il répète que Vladimir Poutine "en paierait les conséquences".
"Nous avons eu une longue conversation lui et moi, je le connais assez bien, explique le dirigeant démocrate. (...) Je lui ai dit: +Je vous connais et vous me connaissez, si j'en viens à la conclusion que vous avez fait cela, soyez prêt" pour les conséquences.
Moscou rappelle son ambassadeur aux Etats-Unis.
«Celui qui le dit qui l'est»
Le lendemain, Vladimir Poutine rétorque par la moquerie: "C'est celui qui le dit qui l'est! Ce n'est pas juste une expression enfantine, une blague (...), nous voyons toujours en l'autre nos propres caractéristiques".
"Nous défendrons nos propres intérêts et nous travaillerons avec (les Américains) aux conditions qui nous seront avantageuses".
Il propose une "discussion" diffusée en direct: "cela serait intéressant pour le peuple russe, le peuple américain et pour beaucoup d'autres pays".
Silence américain.
"C'est encore une occasion gâchée pour sortir de l'impasse des relations russo-américaines qui existe par la faute de Washington", déplore Moscou.
«Le moment de la désescalade est venu»
Le 15 avril, Joe Biden signe des sanctions contre la Russie "si elle continue d'interférer dans notre démocratie", en référence à la gigantesque cyberattaque de 2020.
Ces sanctions, les plus dures depuis Barack Obama, s'ajoutent à des mesures prises en mars après l'affaire Navalny.
"Le moment de la désescalade est venu", lance-t-il en proposant un sommet bilatéral "cet été en Europe" pour "lancer un dialogue stratégique sur la stabilité" en matière de désarmement et de sécurité.
«Je l'espère et j'y crois»
Le 4 mai, Joe Biden répète espérer rencontrer son homologue. "Je l'espère et j'y crois. Nous y travaillons".
Mi-avril, il avait proposé une rencontre. Vladimir Poutine avait laissé ses porte-parole répondre, le Kremlin assurant que des "dates concrètes" étaient à l'étude.
«Ils violent les droits»
"Je vais rencontrer le président Poutine dans deux semaines à Genève, annonce Joe Biden le 30 mai. Et je dirai clairement que nous ne resterons pas les bras croisés pendant qu'ils violent les droits (humains)".
"Nous ne nous faisons pas d'illusions et nous n'essayons pas de donner l'impression qu'il y aura une percée, des décisions historiques amenant des changements fondamentaux", rétorque le 1er juin, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.
«Machiste»
Interrogé samedi sur l'épithète de "tueur", Vladmir Poutine a eu un petit rire: "(...) je me suis habitué à des attaques sous tous les angles et de toutes parts sous toutes sortes de prétextes et de raisons, et de différents calibres et violence, et rien de tout cela ne me surprend", ajoutant que "tueur" est un un terme "machiste" propre à Hollywood.
Un tel discours "fait partie de la culture politique américaine où cela est considéré comme normal. Mais pas ici, au fait".