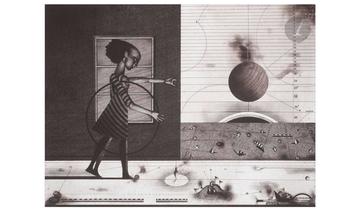PARIS: Fichu noué sur la tête et marteau en main, Faten Al-Ali brise de petits morceaux de mosaïque, qui formeront bientôt une œuvre. Voilà cinq ans que la Syrienne est arrivée en France et, enfin, elle touche du doigt son rêve: renouer avec sa vie d'artiste.
"Je retrouve ma vie d'avant. Le travail, c'est pas juste l'argent, c'est quelque chose d'intime. Etre artiste, j'ai ça dans le sang, je ne peux rien faire d'autre", exulte en français l'ancienne Damascène de 48 ans, dans l'atelier parisien de la Fabrique nomade, une association qui tente de remettre le pied à l'étriller des immigrés artisans d'art.
Poussée à l'exil par la guerre civile, cette mosaïste autodidacte qui travaillait depuis quinze ans le vitrail, la fusion de verre et la céramique avant de quitter la Syrie en 2011, a dû attendre quatre ans en Egypte de pouvoir rejoindre son mari à Paris.
"J'ai beaucoup souffert pour reprendre mon travail, pour apprendre la langue française... Mais maintenant j'apprends de nouvelles choses, les goûts des Français. Il y a de nouveau l'espoir", dit-elle.
L'association accueille une douzaine de migrants de tous horizons en quête, comme elle, d'une passerelle vers des emplois qu'ils maîtrisent mais qui leur sont fermés.
"Ils rencontrent tous les mêmes freins: la langue, la méconnaissance du marché, l'absence de reconnaissance de l'expérience professionnelle dans le pays d'origine et, surtout, l'orientation vers les secteurs comme le ménage, le BTP, la restauration, l'hôtellerie", regrette Inès Mesmar, fondatrice de la Fabrique nomade.
«Gâchis»
L'ambition, explique-t-elle, est de "valoriser leurs compétences, leur permettre de s'insérer grâce à leur savoir-faire".
En cinq ans d'existence, l'association s'enorgueillit d'un taux d'insertion professionnelle de 76%, dont 56% dans les métiers d'art.
Des chiffres d'autant plus encourageants que l'insertion a encore "beaucoup de progrès à faire", selon un rapport parlementaire sur le sujet présenté en septembre dernier, et que l'artisanat "fait face à des besoins importants, avec des métiers pour lesquels il n'y a plus de transmission en France", résume Inès Mesmar.
Son engagement lui vient d'une histoire personnelle: en 2015, au pic de la crise migratoire, l'ethnologue de formation découvre que sa mère était autrefois brodeuse dans la médina de Tunis, avant d'abandonner son métier lorsqu'elle a émigré en France.
"J'ai pris conscience du gâchis que ça représente, ces personnes obligées d'oublier qui elles sont pour gagner leur vie", raconte la fondatrice de l'initiative, soutenue notamment par le géant LVMH.
Un nom qui fait rêver Hemantha Kuragamage, bijoutier srilankais de 50 ans, qui en paraît dix de moins.
Lui a tout tenté pour revenir à ses premières amours, depuis qu'il a atterri en France en septembre 2016. En vain. "Toutes les entreprises me demandaient un diplôme français", souffle celui qui a tout appris avec son oncle à Colombo, où il a exercé près de vingt-cinq ans.
Il a dû alors se rabattre sur un emploi alimentaire, trois ans comme pizzaïolo.
S'adapter au marché
"Joailler, j'aime ce métier, c'est celui que je connais", dit-il entre deux coups de chalumeau pour façonner une bague. Le reprendre "me permettrait d'avoir une vie meilleure, de gagner plus d'argent, et c'est une façon d'être plus intégré en étant vu comme un vrai professionnel".
Il est proche du but, à en croire Nicolas Tappou, joailler de la prestigieuse maison Chaumet, qui vient une demi-journée par semaine pendant six mois pour accompagner Hemantha et son compatriote Beragama Saman, un taiseux de 45 ans, dont trente à travailler les bijoux.
"Ils connaissent déjà leur métier. Moi j'essaie de leur apporter de nouvelles façons de faire, des touches française et parisienne, sur la haute joaillerie", explique-t-il. Objectif: "adapter leurs techniques" au marché français.
Le formateur en est convaincu, les entreprises ont intérêt à recruter ces profils, qui peuvent "apporter leurs propres techniques et cultures".
Pour Ahmed Ly, Sénégalais longiligne de 35 ans, l'équation est différente. L'industrie du textile manque de main d'œuvre et, avant même d'intégrer la promotion, le couturier a commencé à collaborer avec une styliste parisienne spécialisée dans le tissu wax, aux motifs africains.
"Je veux surtout me faire un carnet d'adresses", anticipe-t-il. "Et si les gens sont épatés par ce que je fais, peut-être que j'arriverai à me faire une vraie place."