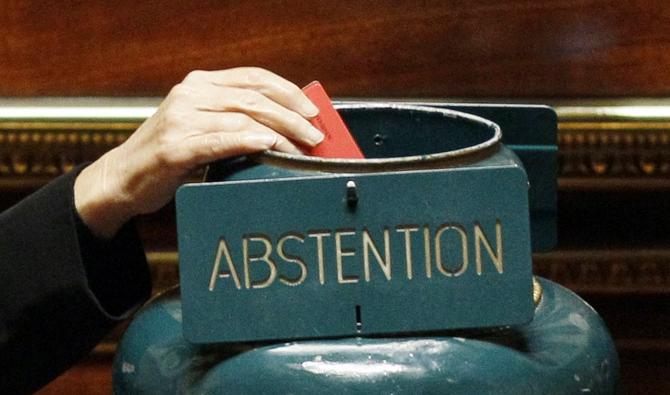PARIS: La montée inexorable de l'abstention, devenue spectaculaire avec les élections municipales de 2020 et régionales de 2021, a conquis de nouveaux territoires, aussi bien géographiques que sociologiques, qui seront scrutés avec attention lors de la présidentielle dans quatre mois.
L'abstention s'est durablement installée dans le paysage politique français à partir de la fin des années 80, en franchissant un premier seuil de 30% d'abstentionnistes lors des législatives de 1988.
Mais depuis la victoire d'Emmanuel Macron en 2017, le phénomène s'est accéléré et l'abstention a battu des records à chaque élection, à l'exception des européennes de 2019, pour culminer lors des régionales en juin (66,72% et 65,31%), soit 31 millions de Français qui ont boudé les urnes sur un corps électoral de 47,9 millions d'inscrits.
Extension sociologique
Si les facteurs les plus déterminants du désengagement électoral sont les mêmes depuis 40 ans (jeunesse, faible niveau de diplômes et fragilité économique), le phénomène change de physionomie quand il atteint une telle ampleur, en conquérant de nouvelles populations.
Les abstentionnistes, réserves de voix surtout pour la gauche et le RN ?
Après l'abstention record des régionales, tous les candidats appellent à un regain de participation électorale en avril lors de la présidentielle, mais selon une étude de la Fondation Jean-Jaurès, c'est surtout la gauche et le RN qui auraient le plus à y gagner.
Car, comme le soulignent les spécialistes des élections, le premier enjeu pour un candidat ou un parti, c'est de réussir à mobiliser ses électeurs potentiels.
Et en la matière, ce sont surtout Jean-Luc Mélenchon (LFI) et Yannick Jadot (EELV), et, à un degré moindre, Anne Hidalgo (PS) et Marine Le Pen (RN), qui ont les plus grandes marges de progression dans les récents sondages d'intention de vote, avertit Antoine Bristielle, directeur de l'Observatoire de l'Opinion de la Fondation Jean-Jaurès et auteur de cette étude publiée fin novembre.
"On se rend compte qu'on a une abstention qui est assez différentielle en fonction des électorats, en fonction des candidats", explique-t-il à l'AFP, en précisant qu'"à l'heure actuelle, l'électorat qui est le plus mobilisé, c'est celui d'Eric Zemmour, et au contraire celui qui est le moins mobilisé, c'est celui de Jean-Luc Mélenchon".
Dans le détail, en se basant sur l'enquête électorale de l’institut de sondage Ipsos pour Le Monde et la Fondation Jean-Jaurès, Antoine Bristielle montre que parmi les personnes qui déclarent vouloir voter pour Eric Zemmour, il y en a 70% qui sont certaines d'aller voter. Pour LR (c'est Xavier Bertrand qui avait été testé), 69% sont certaines d'aller voter, pour Emmanuel Macron 67%, alors que pour Jean-Luc Mélenchon, on est seulement à 55% (à 61% pour Jadot, à 64% pour Le Pen et à 65% pour Hidalgo).
Le contraste est encore plus net entre les électeurs de droite (66% certains d'aller voter) et ceux de gauche (57%).
"Quand on regarde les sondages d'opinion à l'heure actuelle, la gauche est à un niveau extrêmement faible et assez loin du seuil de qualification pour le second tour mais elle a des réserves de voix potentielles", analyse Antoine Bristielle.
"Tout l'enjeu de la campagne, ça va être: est-ce qu'elle va être en mesure de les mobiliser pour potentiellement réussir à gagner quelques points et éventuellement accéder au second tour ?", ajoute-t-il.
Les partis politiques en sont d'ailleurs bien conscients, à l'instar de LFI qui a fait du combat contre l'abstention sa priorité pour cette campagne électorale.
"Notre principal adversaire, c'est la résignation et l'abstention. Si les milieux populaires se mobilisent alors nous pouvons être qualifiés au second tour", clame le numéro deux de LFI Adrien Quatennens.
Même analyse à l'autre bout du spectre politique pour le RN. "Vu que Marine Le Pen a un électorat très populaire qui se mobilise le plus tardivement, elle est à des seuils qui sont assez bas dans les enquêtes d'opinion", explique Antoine Bristielle.
Mais "si elle réussit à mobiliser cet électorat lors de la campagne, ce qui se fait traditionnellement, elle pourrait gagner justement les quelques points qui lui permettraient d'avoir une marge un petit peu plus confortable sur Eric Zemmour et d'accéder au second tour", fait-il valoir.
Pour le politologue Pascal Perrineau, l'abstention touche "aujourd'hui des électrices et des électeurs intéressés par la politique et par la chose publique, qui ne sont exclus ni culturellement ni socialement".
"Elle touche absolument tout le monde, même les professions intellectuelles et la bourgeoisie", insistait-il lors d'une audition parlementaire en octobre, en prenant l'exemple de ses étudiants de Sciences Po Paris, où, selon lui, "aujourd'hui, environ 40 % des étudiants affirment ne pas avoir l'intention d'aller voter".
Et si les catégories socio-professionnelles continuent de déterminer la participation, l'abstention aux régionales a été si forte qu'elle a réduit les écarts en progressant plus rapidement chez les catégories les plus aisées.
Au premier tour des législatives en 2017, l'abstention concernait 45 % des cadres contre 66 % des ouvriers, mais cet écart s'est réduit à six points aux dernières élections régionales, relève un récent rapport parlementaire sur le sujet.
Nouvelle géographie
De la même façon, la poussée de l'abstention a enrichi sa géographie.
Depuis longtemps, des villes populaires de banlieue sont identifiées comme des bastions historiques de l'abstention. Hors présidentielle, une commune comme Vénissieux, en banlieue sud de Lyon, enchaîne les chiffres vertigineux d'abstentionnistes à chaque scrutin: 67% des inscrits ont boudé les urnes aux régionales de 2015 et aux législatives de 2017, 65% aux européennes de 2019. Puis dans un contexte de Covid, 71% des inscrits se sont abstenus aux municipales de 2020 et 83% aux régionales 2021.
Durtal, son château, ses 3 400 habitants et son abstention à 80%
"Je m'y intéresse très peu", "je trouve ça compliqué": à Durtal, commune de 3.400 habitants dans le Maine-et-Loire où le taux d'abstention atteint des sommets, il est difficile de trouver des citoyens motivés par la présidentielle.
Sur le marché, au pied d'un superbe château Renaissance et à proximité des flots tumultueux du Loir, les candidats ou les programmes politiques font peu recette dans cette commune qui a connu un taux d'abstention frôlant les 80% aux régionales et départementales en juin remportées par la droite.
"Je ne me plains pas, comme je ne m'y intéresse pas, je n'ai pas grand-chose à dire", explique Candice Vincent, 31 ans, en remballant ses produits. "On respecte les opinions de chacun mais ce n'est pas souvent qu'on échange autour de la politique" avec les amis, car ce sont "des sujets à dispute", ajoute cette ancienne infirmière.
Franck, tourneur fraiseur de 48 ans, "n'a jamais voté". Et ça ne devrait pas changer en avril prochain, même si "Emmanuel Macron, de ce que j'ai vu, a fait des bonnes choses dernièrement pour les gens à faibles revenus", comme lui.
Dans son camion charcuterie, Anthony Dalibon, 34 ans, se souvient d'avoir entendu gamin "ses parents parler politique. Nous, entre copains, on n'en parle jamais", reconnaît-il, ajoutant qu'il devrait toutefois se rendre aux urnes au printemps "en se basant sur les programmes reçus" par courrier.
La patronne du bar "A Casa" Marie-Christine Orsini, 67 ans, tente une explication. "Beaucoup de gens pensent des choses et ont peur d'en parler (...), un peu comme quand on parle d'argent", glisse-t-elle, évoquant la crainte de discorde. Il lui semble loin l'époque où le comptoir était "le parlement du peuple", selon le mot de Balzac.
"Dans les années 1990, il y avait des piliers de bar. Le Covid a vidé les lieux. Nos petits vieux qui étaient assis au bar les jours de marché, qui refaisaient le monde, c'est fini...", maugrée-t-elle. Cette femme d'origine corse, qui à une époque a eu pour client le socialiste Michel Rocard, confie son "inquiétude" pour la démocratie.
Attitude « très très perso »
Pour Renée Barret, 84 ans, issue d'une famille gaulliste, voter est "un devoir". Et elle pointe l'individualisme. "On se désintéresse de beaucoup de choses. Je crois que tout le monde est très très perso et les gens ne s’occupent que d’eux-mêmes", s'attriste la vieille dame rencontrée devant l'office de tourisme.
En 2020, le maire Pascal Farion, qui n'a pas souhaité répondre à l'AFP, a été élu par 27,16% des inscrits (693 voix sur 2.553 inscrits). L'ancienne maire Corinne Bobet regrette que "les gens ne s'engagent plus comme auparavant. On a ce phénomène également dans toutes nos associations, qu'elles soient sportives ou culturelles. On voit bien que le bénévolat a du mal".
A l'occasion d'une législative partielle en 2020, pendant la crise sanitaire, Anne-Laure Blin (LR) a été élue avec une participation famélique de 17,84%. Concrètement, cela signifie que la nouvelle députée a obtenu 7.329 bulletins de vote dans une circonscription comptant... 71.034 inscrits. Et à Durtal, où elle est arrivée en tête, 166 personnes ont voté pour elle.
"Quand on est responsable politique il faut tenir compte de cette abstention pour avoir une action au plus près des concitoyens", explique Mme Blin. "Je fais une tournée de l'ensemble des villages de mon territoire, ça me semble très important que les citoyens identifient leurs élus et leur disent de façon très simple leur préoccupation du moment. Malheureusement il y a un détachement et un éloignement du citoyen et du politique", ajoute cette ancienne juriste.
Selon le politologue Romain Pasquier, directeur de recherche au CNRS, en France, "on est sur des niveaux de défiance des institutions de l'action publique très très hauts par rapport à nos homologues européens".
Et l'abstention connaît une "augmentation tendancielle et globale", souligne Thomas Frinault, maître de conférence en sciences politiques à Rennes 2, même si elle touche moins la présidentielle. Au deuxième tour de 2017, l'abstention n'avait atteint que 22% à Durtal.
Même constat en banlieue parisienne ou en régions dans des villes affectées par la désindustrialisation, à l'instar de Hayange en Lorraine avec quelque 64% d'abstentionnistes aux législatives de 2017 comme aux municipales de 2020.
Mais désormais, des territoires qui étaient relativement épargnés par l'abstention sont touchés à leur tour.
Même si les régionales de 2021, dans le contexte particulier du Covid, ont connu des records d'abstention partout (sauf en Corse), certains chiffres ont plus surpris que d'autres, comme dans les Pays de la Loire (68% d'abstention).
Des petits villages guère abstentionnistes habituellement y ont été particulièrement confrontés comme Morannes sur Sarthe (76% d'abstentions) ou Durtal, dans le Maine-et-Loire (près de 80%).
Les facteurs explicatifs ne sont pas toujours simples à appréhender. Dans un rapport pour la fondation Jean-Jaurès, le politologue Jérôme Fourquet évoque le "cas" particulier du littoral atlantique et breton, qui combine une "forte proportion de seniors et un taux d'abstention élevé".
Il y note la "perte de force du rite républicain" au niveau local, en raison d'un "intense brassage de population". "De nombreux retraités installés dans ces communes balnéaires ne sont pas originaires de la région et entretiennent avec elle un lien plus distendu", avance-t-il.
Reste à savoir si la présidentielle saura leur faire retrouver le chemin des urnes. "Même l'élection reine de la Ve République n'est pas à l'abri d'une surprise abstentionniste, malgré l'intérêt que les Français continuent à avoir pour elle", met en garde le politologue Pascal Perrineau.