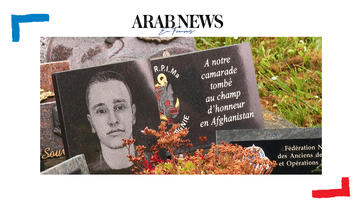PARIS : Le flou règne sur leur vie: depuis la France, les migrants afghans sont catastrophés par la prise de pouvoir des talibans, conscients qu'un retour à Kaboul est plus que jamais exclu, mais aussi que la procédure d'asile s'est complexifiée depuis la fin 2020 dans l'Hexagone.
Déboussolé, Khalil Rahimi fait partie de la minorité d'Afghans à qui la France refuse d'accorder sa protection. Mais pour lui, « rentrer en Afghanistan, c'est impensable ».
Musique interdite, lapidation des femmes soupçonnées d'adultère, longueur de barbe réglementaire pour les hommes... Le retour au pouvoir des talibans à Kaboul réveille le souvenir des diktats imposés dans ce pays d'Asie centrale entre 1996 et 2001.
« Là-bas, ils me prendraient pour un mécréant, ou pire pour un chrétien », craint le jeune homme de 24 ans, non pratiquant.
Khalil a été débouté de sa demande d'asile début 2021, quelques mois après que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a changé sa politique concernant les Afghans, premier contingent à réclamer une protection en France avec environ 10 000 demandes par an.
Cette institution devant laquelle les migrants refusés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) font appel, appliquait auparavant la « jurisprudence Kaboul ».
A défaut du statut de réfugié, réservé aux cas de persécution individuelle, elle attribuait à l'immense majorité des Afghans une « protection subsidiaire », motivée par la violence aveugle générée par le conflit armé dans la capitale afghane, point de passage obligé en cas de rapatriement.
Mais depuis novembre 2020, la CNDA a officiellement changé de pratique. Elle raisonne désormais au cas par cas, en fonction du niveau de violence estimé région par région, avec un code couleur pour chaque province, du rouge au gris.
C'est ce qui a motivé le refus opposé à Khalil: Daikundi, la province dont il est originaire dans le centre de l'Afghanistan, est jugée « pas assez dangereuse », explique le jeune homme, qui a demandé un réexamen.
Polémique sur l'immigration
Ces nouvelles pratiques, validées en juillet par le Conseil d’État, au moment où les talibans avaient déjà entamé leur reconquête du pays, ont des conséquences très concrètes, selon Héloïse Cabot. L'avocate, qui défend « une dizaine d'Afghans par semaine » devant la CNDA, assure qu'elle "perd des dossiers qu'on ne perdait pas avant".
Contactée par l'AFP pour savoir si l'avènement des talibans change sa manière de juger, la CNDA n'a pas répondu.
Le gouvernement a lui suspendu depuis début juillet les expulsions de migrants afghans.
Mais professionnels et associations s'inquiètent des effets de la nouvelle jurisprudence et réclament son abandon, notamment après la polémique suscitée par Emmanuel Macron en début de semaine.
Au moment où la chute de Kaboul réveille en Europe le spectre de la crise migratoire provoquée par le conflit syrien, le président a assuré que la France aiderait les Afghans « qui sont les plus menacés », tout en avertissant qu'elle devrait se "protéger contre les flux migratoires irréguliers importants".
Des propos « indignes de la tradition française de l'accueil et de l'asile », ont fustigé dans un communiqué plusieurs organisations, dont la Ligue des droits de l'homme et la Cimade, association de soutien aux migrants.
« La situation est dramatique. Nous devons prévoir des procédures simplifiées et rapides pour accueillir les Afghans », insiste le président de la Cimade, Henry Masson.
De son côté, l’Élysée rappelle que la France reste l'un des pays les plus accueillants d'Europe à leur égard.
Selon la présidence, 64% des demandes d'asiles d'Afghans examinées par l'Ofpra depuis début 2021 ont débouché sur une protection. Après examen des recours devant la CNDA, ce chiffre grimpe à 89,9%, contre une moyenne de 63% sur l'ensemble de l'UE.
Mais ces statistiques ne suffisent pas à rassurer les associations. « La jurisprudence de la CNDA doit voler en éclats », reprend M. Masson à la Cimade. « On ne peut pas faire confiance aux propos lénifiants des talibans », qui promettent actuellement une amnistie générale et certains droits pour les femmes.
Les talibans « se montrent un peu modernes et modérés. Mais en réalité, ils n'ont pas du tout changé », abonde Reza Jafari, de l'association Enfants d'Afghanistan et d'ailleurs, en rappelant les témoignages qui émergent des zones rurales, où les combattants sont accusés de brutaliser la population. « Aujourd'hui, dit-il, tout l'Afghanistan est en zone rouge et tous les civils sont menacés. »