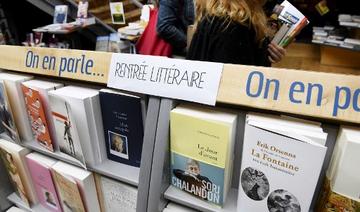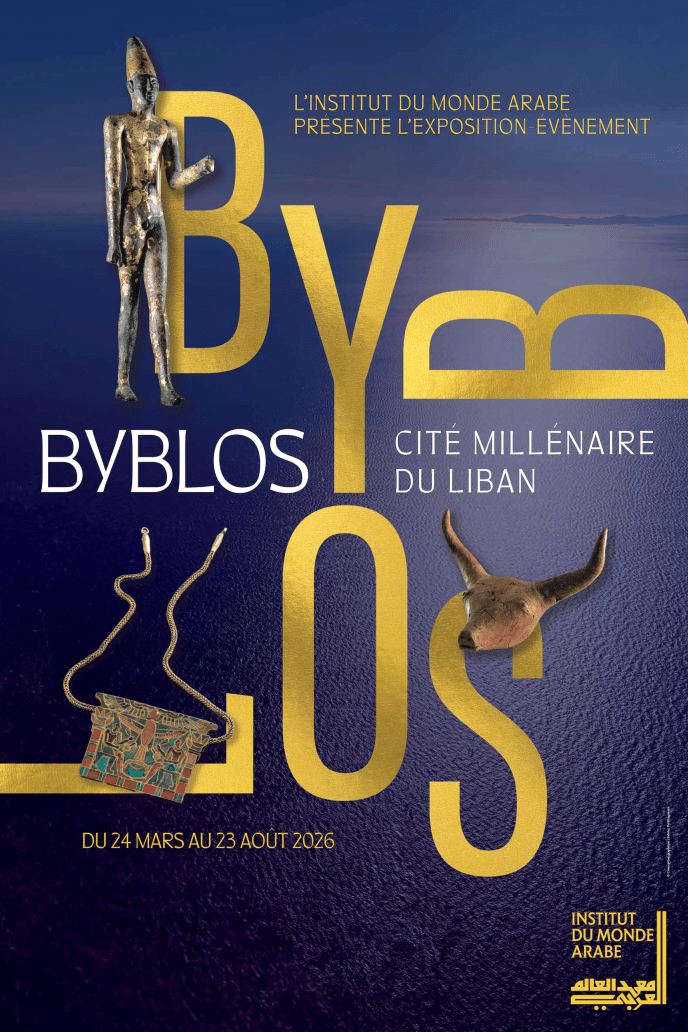PARIS: Sidali Kouidri Filali, chroniqueur et blogueur, publie son premier roman Wallada, la dernière andalouse, aux Éditions Hedna. Il répond aux questions d'Arab News en français, notamment sur l'Andalousie de l'an mille, les discordes politiques, lutte et chute de dynastie qu'il dissèque en profondeur dans Wallada.

Votre premier roman est une immersion dans l’Andalousie de l’an mille à travers l’histoire de la princesse et poétesse Wallada benta el-Moustakfi, fille du dernier calife de Cordoue et des nombreux personnages qui ont joué un rôle dans sa vie. Mais on y découvre aussi l’histoire d’amour de l’héroïne avec Ibn Zeydoun, un homme dévoré par ses deux amours: Wallada et le pouvoir. Pourriez-vous nous en parler?
C’est le récit d’une histoire à travers un grand amour, ou alors, celui d’un amour au milieu d’une grande histoire. L’idylle de Wallada et d’Ibn Zeydoun est un amour très célèbre encore chanté, décrit, commenté, mille ans après. Hélas, le pouvoir ne fait que rarement bon ménage avec l’amour, et c’est ce rapport de force qui définit en dernier sa destinée. C’est le récit de ces deux amoureux qui évoluent dans une époque charnière, faite de personnages iconiques et de renom dans cette mythique Andalousie du XIe siècle. C’est une petite histoire dans une grande, où des destins croisés, les amours, les déceptions et les tiraillements de tous ces personnages gravitent autour de cette célèbre histoire d’amour qui fait encore parler d’elle aujourdhui.
L’idée de départ pour l’écriture de ce livre est-elle nourrie par la passion pour l’Histoire et une envie de s’approprier la part nord-africaine dans l’Histoire de l’Andalousie de cette époque?
Les deux, l’histoire est assez riche de ses personnages et de son actualité et péripéties qu’elle est universelle par son attrait et par sa beauté, ensuite, oui, je la raconte comme un local, un nord-africain, et donc il y a une filiation directe avec cette période. L’Andalousie, c’étaient aussi les Berbères, et pourtant, ce sont les derniers cités dans les romans ou livres d’Histoire. Il est temps de regarder cette partie de l’Histoire comme nôtre, et l’associer à notre Histoire millénaire.

Le roman évoque des faits historiques (discordes politiques, lutte de pouvoir, chute de dynastie), et permet aussi au lecteur de découvrir une période prolifique sur les plans intellectuel, scientifique et artistique. Considérez-vous cette période comme exceptionnelle dans l’Histoire?
C’était une période d’une profusion intellectuelle hors norme. C’est la plus prolifique des périodes médiévales, et ce sont aussi les années les plus foisonnantes de ce siècle-là. Il est rare pour ne pas dire impossible, de croiser au même moment, au même endroit, le meilleur poète de sa génération, le meilleur théologien, la plus connue des poétesses et le plus doué des chroniqueurs. Une concentration dans un même endroit et dans le même moment des meilleurs prodiges de leur époque.
Le roman évoque le féminisme avant-gardiste de l’an mille de notre ère. Cette liberté revendiquée et incarnée jadis par la belle et rebelle princesse poétesse Wallada, facilitée par son statut social, et assumée publiquement, ne semble pas facilement transposable dans nos sociétés modernes. Cela représente-il, selon vous, une régression du statut de la femme?
La régression du statut de la femme est souvent annonciatrice d’une régression globale. Et a contrario, quand le statut de la femme est bon, la civilisation ou l’époque dans lequel cela se produit sont bons. On parle d’une époque prestigieuse et d’une exubérance intellectuelle et sociale exceptionnelle. Le statut de la femme ne pouvait qu’évoluer et c’est ce que nous apercevons à travers les libertés que pouvaient s’offrir les femmes à cette époque-là. Comparativement, et je dirai bizarrement, une musulmane qui évolue dans un pays musulman en ce temps-là, avait plus de libertés artistiques, intellectuelles et sociales que ne peut l’avoir une musulmane aujourd’hui. La civilisation musulmane de cette époque était très évoluée concernant la liberté d’expression ou d’être, contrairement à celle d’aujourd’hui enfermée dans une ignorance entretenue, dans la bigoterie et dans le déni de toutes les libertés, celle de la femme en premier.
Le lecteur voyage dans le temps dans trois villes mythiques de l’Andalousie: Grenade, Cordoue et Séville et découvre le métissage des cultures et des religions, mais aussi les déboires des familles régnantes et l’implosion de la dynastie. Est-ce un moyen plus ludique et plus fluide dans la transmission de l’Histoire de nos ancêtres?
Oui, ne serait-ce que pour dire que ces gens-là ont existé et que leur empreinte dans l’Histoire ne fut pas des moindres. Il est triste que cette partie de notre Histoire demeure inconnue ou alors instrumentalisée et racontée par d’autres. Raconter cette histoire-là, c’est donner vie à de vrais personnages qui n’ont pas eu, selon moi, la renommée qu’ils doivent avoir.
Le lecteur découvre l’apport des Berbères de Sanhadja en Andalousie et les rapports complexes, conflictuels qu’ils entretenaient avec les autres ethnies. Pourriez-vous nous en parler?
Les Sanhadjas sont une importante branche berbère, et si je raconte un peu de cette dynastie en Andalousie, je ne manque pas de signaler l’inimitié qui caractérisait sa relation avec les autres branches berbères. C’est une hostilité qui existe depuis des millénaires. Un phénomène qui caractérise les peuples à construction tribale. Un peu comparable à celle existante chez les Arabes, entre Adnanites et Kahtanites, ou entre les Mongols et les Tatars. Ce sont deux branches qui forment l’essentiel des Berbères mais qui se sont rarement mises d’accord. D’ailleurs, cette inimitié a toujours servi leurs ennemis communs, et c’est exactement ça que je tente de raconter dans le roman.
Dans Wallada, la dernière andalouse, le lecteur perçoit cette tolérance et/ou cette coexistence entre religions et ethnies durant cette période. Cette dernière est-elle irréalisable dans nos sociétés modernes?
Réalisable, je ne sais pas, cela dépend tellement de la politique et de la géographie. Elle peut être possible à New York et un peu moins en Libye ou en Irak. La question pour moi est surtout de se demander si c’est possible! Et là, l’Andalousie est une réponse d’une affirmation sans équivoque, oui, tout à fait possible et cela a permis des avancées mémorables dans tous les domaines, même si cette coexistence reste imparfaite. Raison de plus pour étudier l’Histoire de l’Andalousie de près. Il s’agit précisément de pouvoir se dire que oui, à un moment, juifs, chrétiens, musulmans, Slaves, Arabes, Berbères, Goths, ont partagé les mêmes ruelles, les mêmes écoles, la même destinée, et que ce que l’on retient des siècles après, ce ne sont pas les imperfections, mais bien au contraire, la convivencia et le vivre-ensemble. C’est d’ailleurs la première chose à laquelle on pense en évoquant l’Andalousie, bien avant l’architecture sublime et le foisonnement culturel.