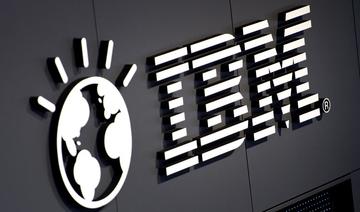PARIS: Où trouver les milliards pour financer une usine de semi-conducteurs ou l'avion à hydrogène ? Pour rester dans la course mondiale à l'innovation, la France privilégie des alliances industrielles avec d'autres pays européens, faute d'avoir la taille critique pour supporter seule de lourds investissements.
De la pénurie de masques ou respirateurs à l'échec initial de Sanofi à produire un vaccin contre la Covid-19, la pandémie aura révélé l'ampleur de la dépendance française aux importations, nourrissant un sentiment de déclassement.
Si la plupart des pays développés ont connu ce phénomène de désindustrialisation lié à la division internationale du travail et la montée en gamme des pays développés, il a été beaucoup plus massif dans l'Hexagone.
Parmi les causes identifiées par les nombreux rapports qui se sont succédé depuis dix ans, un coût du travail et une fiscalité trop élevés qui ont conduit les grandes entreprises à délocaliser massivement plutôt que d'investir en France pour produire et exporter.
Du redressement productif au plan de relance, 10 ans de tentatives pour réindustrialiser la France
PARIS: Du ministère du Redressement productif au plan de relance post-Covid, les gouvernements successifs ont tenté d'enrayer la désindustrialisation de la France ces dix dernières années à grands coups de mesures fiscales et d'investissements, avec des résultats encourageants mais pas toujours concluants.
L'épidémie de Covid-19, qui a entraîné ou exacerbé des pénuries de produits vitaux subies par la France, a provoqué un électrochoc. "La désindustrialisation est devenue plus tangible pour tout le monde", résume Alexandre Saubot, président de France Industrie.
Mais la prise de conscience a commencé il y a une dizaine d'années, avec notamment en 2012 le rapport de Louis Gallois, alors ex-président d'EADS, sur la "compétitivité" de l'économie française.
Il y expliquait le déclin industriel français par "un climat des affaires plus défavorable en France qu'ailleurs", résume Vincent Aussilloux, économiste à France Stratégie, organisme chargé de conseiller le gouvernement.
Le constat était sans pitié: les emplois salariés dans l'industrie ont fondu, passant de plus de 5 millions en 1980 à un peu plus de 3 millions en 2011, la part de marché des exportations françaises en Europe a perdu plus de 3 points sur la période, et la balance commerciale est passée d'un excédent de quelques milliards d'euros au début des années 2000, à un déficit de plus de 70 milliards en 2011.
"Mon rapport (...) a agi comme un gong. Du coup, le mot compétitivité n'était plus un mot tabou", se souvient Louis Gallois.
Conséquence: un gouvernement de gauche "a admis la nécessité d'une politique de l'offre, ce qui était une révolution", analyse Vincent Charlet, délégué général de la Fabrique de l'Industrie, think tank créé en 2011.
En découle une stratégie visant à "améliorer le système fiscal français pour moins pénaliser les industriels" et "développer des outils de politique industrielle", explique Vincent Aussilloux.
CICE et Nouvelle France industrielle
C'est la naissance du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) pour réduire les coûts des entreprises - dont l'efficacité sera critiquée par la suite -, la création de la banque publique d'investissement Bpifrance ou encore le lancement du 2e Programme d'investissement d'avenir (PIA) - qui sera suivi d'un 3e en 2017 et d'un 4e cette année. Et en 2014, le Pacte de responsabilité accentue les baisses de charges pour les entreprises.
La création en 2012 du ministère du Redressement productif dirigé par le chantre du "Made in France" Arnaud Montebourg illustre la volonté de relancer une stratégie active en matière industrielle.
Le bouillonnant ministre met sur pied 34 plans sectoriels (énergies renouvelables, TGV du futur, chimie verte, etc.) pour une Nouvelle France industrielle, qui n'évitent pas l'écueil du "saupoudrage" d'argent public, selon Alexandre Saubot.
Ils seront ramenés à une dizaine par son successeur à Bercy, Emmanuel Macron, qui une fois devenu président continue sur la même lancée du développement de secteurs jugés stratégiques.
«Décennie de convalescence»
La décennie écoulée marque le retour à "des politiques sectorielles verticales", impulsées par l'Etat, un peu comme sous l'ère De Gaulle-Pompidou, "mais sans forcément leur allouer des sommes significatives", décrypte Vincent Charlet.
Et "le contexte est différent. Aujourd'hui l'Etat n'est plus aussi puissant que dans les années 60", avec une présence au capital d'entreprises industrielles largement émoussée, qui réduit ses marges de manoeuvre, avance Vincent Aussilloux.
Mais au mitan des années 2010, les premiers résultats émergent. Entre 2015 et 2018, la France crée plus de sites industriels qu'elle n'en ferme, et à partir de 2018, l'emploi industriel repart doucement à la hausse.
"La décennie 2010 a été une forme de convalescence après une décennie compliquée", aidée aussi par l'augmentation des salaires en Allemagne, juge Vincent Charlet.
La crise sanitaire donne l'occasion de mobiliser des moyens conséquents au développement de secteurs jugés stratégiques: la santé, l'agroalimentaire, le numérique, etc.
Impôts de production
Plus de 30% des 100 milliards du plan de relance sont orientés vers l'industrie. "C'est plus de deux fois la part actuelle de l'industrie dans notre produit intérieur brut (PIB)", souligne M. Saubot.
"Le financement du long terme, des secteurs d'avenir, me parait encore prudent", pointe cependant Vincent Charlet.
Pour l'industrie, le gros de l'effort budgétaire de ce plan ce sont en effet les 10 milliards d'euros de baisses d'impôts de production, considérés comme un des principaux handicaps de la France par rapport à ses voisins.
Une telle baisse était réclamée de longue date par les entreprises et de nombreux économistes, même si certains demandent déjà d'aller plus loin, et comptent bien porter cette revendication durant la campagne présidentielle à venir.
Résultat, en 2019, l'industrie manufacturière tricolore ne représentait plus que 11% du PIB (et 10% de l'emploi), contre 16% en moyenne dans l'Union européenne, 17% en Italie, 19% en Suisse et 22% en Allemagne.
Pour expliquer ce décrochage, Philippe Aghion, professeur au Collège de France, pointe du doigt un "déficit d'innovation", mesurable notamment au nombre de brevets par millions d'habitants de la France, comparé aux autres grands pays industrialisés.
"Toutes industries confondues, nous étions devant l'Allemagne en 1995 mais elle nous a dépassés".
Des télécoms à la pharmacie en passant par l'automobile, le textile - "et même le vin" - le pays de Pasteur "a perdu partout, sauf dans le nucléaire et l'aéronautique". Ainsi que sur certaines niches, comme l'isolation thermique du bâtiment ou la conception assistée par ordinateur.
«mini-Airbus»
Pour l'auteur du "Pouvoir de la destruction créatrice", la priorité est de consolider les filières qui marchent, à commencer par le nucléaire, et d'investir pour en développer de nouvelles en soutenant les jeunes pousses.
Encore faut-il pouvoir supporter les coûts fixes élevés que comporte l'entrée sur un marché de pointe: pour les semi-conducteurs, où l'Asie occupe déjà de solides positions, le ticket d'entrée est évalué entre 20 et 40 milliards d'euros. D'où la volonté de Paris d'unir ses forces avec d'autres pays européens, et de s'adosser à l'UE, afin de décupler sa capacité d'investissement.
A l'initiative de la France et de l'Allemagne, des alliances appelées "PIIEC" (projet important d'intérêt européen commun) ont déjà été conclues dans les batteries électriques, l'hydrogène et bientôt les semi-conducteurs, en attendant les lanceurs spatiaux ou le "cloud".
Vincent Charlet, délégué général de La Fabrique de l'industrie, doute cependant que l'ambition européenne soit à la hauteur, au vu des montants engagés : moins de 3 milliards d'euros pour le "mini-Airbus des batteries", qui seront co-investis par 7 pays membres dans 17 entreprises. Du saupoudrage.
"La France a réussi à faire émerger une filière électronucléaire" et "une filière aéronautique conquérante avec ses partenaires européens" qui a donné naissance à Airbus, "mais pour l'obtenir ils ont employé les grands moyens", soit "un à 2 milliards par an".
Economiste au CEPII (Centre d'études prospectives et d'informations internationales), Thomas Grjebine juge qu'il est "important d'avoir une politique industrielle européenne". Cependant, "la France ne pourra espérer se réindustrialiser si les divergences macroéconomiques perdurent au sein de la zone euro".
Il rappelle que la "politique de compression de la demande" initiée par l'Allemagne à la fin des années 90 "a joué un rôle dans l'accélération de la désindustrialisation en France", Berlin ayant "gagné des parts de marché au détriment de ses voisins".
Ce dont témoigne la béance entre le déficit commercial français, qui a frôlé en 2020 les 70 milliards d'euros, et un excédent allemand, bien qu'en baisse à cause de la crise, qui a atteint 180 milliards d'euros.
Un déséquilibre qui risque de perdurer si les conservateurs allemands remportent les élections en septembre, selon lui. "Les efforts de la France pour baisser ses impôts de production sont anéantis si les voisins compressent leur demande et n'achètent pas vos produits", illustre M. Grjebine.