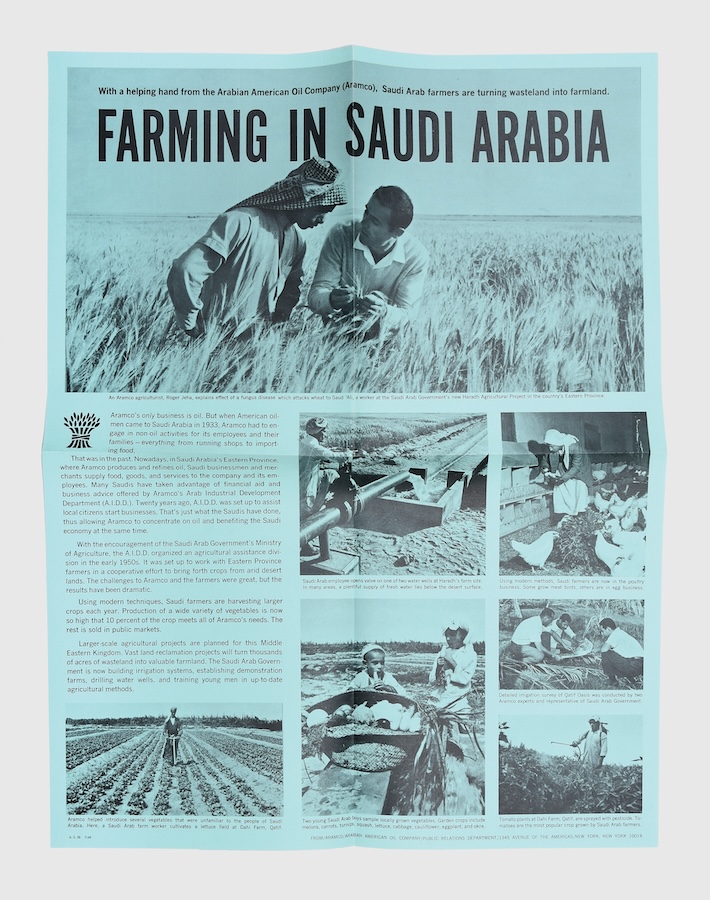Quand je commence à lire un livre, je suis une règle simple pour décider de poursuivre ou non la lecture. Si le livre ne parvient pas à attirer mon attention dans les quatre-vingt-dix premières secondes, je le pose et ne le reprends plus jamais.
C'est pourquoi j'ai brièvement hésité lorsqu’un de mes bons amis, le conseiller gouvernemental de renommée internationale Simon Anholt, m'a demandé de revoir son nouveau livre, The Good Country Equation. Je connais Simon depuis 2008, alors qu'il donnait des conférences dans le monde entier et qu’il était interviewé par les principaux organes de presse. À l’époque, je me faisais encore les dents en tant que rédacteur en chef junior de la publication sœur d'Arab News, le quotidien londonien Asharq Al Awsat. Simon a eu la gentillesse de proposer de discuter de son travail.
Le résultat a été une interview d'une page intitulée «The Man Who Sold the World», en français «L'homme qui a vendu le monde» (bien que le titre ne sonne pas aussi cool en arabe… j'étais un fan de Nirvana à l’époque). C'était la première explication en arabe de Nation Brands, un terme que Simon lui-même avait inventé en 1998. Au moment où je l'ai rencontré, il avait également développé le Nation Brand Index (NBI), qui mesure scientifiquement l’opinion publique à l'égard des marques nationales.
Bien sûr, le sujet en lui-même est fascinant et l'interview a attiré beaucoup d'attention dans le monde arabe. Mais ce qui a été plus fascinant pour moi, c'est de suivre de près l'évolution de ce concept. Ce que j'ai eu la chance de faire de première main, puisque Simon et moi sommes restés en contact et sommes devenus amis.
Ainsi commence mon hésitation… Que faire si je devais appliquer ma règle et abandonner le nouveau livre de Simon après quatre-vingt-dix secondes? En tant qu'ami, je suis ravi de pouvoir dire que je ne l'ai pas fait! En fait, il a capté mon attention presque immédiatement. «Avez-vous remarqué combien de temps nous passons à nous soucier de l'état du monde ces jours-ci?», est-il écrit dans la préface du livre. En tant que rédacteur en chef d'un grand journal régional, une grande partie de mon travail consiste à m'inquiéter de l'état du monde.
En effet, quiconque ne se soucie pas de ce qui se passe autour de nous aujourd'hui est soit naïf soit égoïste. Il y a eu un échec mondial catastrophique pour faire face à de la pandémie de coronavirus. Et le monde a connu une série de catastrophes naturelles monstrueuses – les incendies horribles en Australie et en Californie et l’ouragan Sally dans l’est des États-Unis. À un moment de l'histoire humaine, avons-nous jamais été aussi confus sur ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas? Qu'en est-il de la montée internationale des mouvements d'extrême droite? Même le Pentagone a encouragé la croyance en la vie extraterrestre en publiant des vidéos d'objets volants non identifiés.
The Good Country Equation n’offre pas de solution à tous les problèmes du monde et n’essaie pas non plus. Ce qu'il fait, cependant, c'est nous donner l'occasion de réfléchir à la façon dont la pensée gouvernementale a évolué au cours des deux dernières décennies. Ce qui est fascinant, en particulier si vous avez lu les livres précédents de Simon Anholt, c’est la façon dont ses théories ont évolué, et pas nécessairement de la même manière que de nombreux dirigeants mondiaux.
Dans ce contexte, «bon» n'est pas le contraire de «mauvais», mais le contraire d’«égoïste». Pour qu'un pays soit classé comme «bon» (et obtienne un score élevé dans le Good Country Index créé par l'auteur), il doit être un bon pays non seulement pour sa propre population, mais aussi pour les autres. C'est l'opposé de la vague «mon pays d'abord» que les politiciens de nombreuses démocraties établies (et de régimes non-démocratiques) chevauchent depuis quelques années. Et bien que cette vague puisse gagner le soutien de la population, elle n'est pas nécessairement durable ou saine pour le bien-être mondial.
Si nous avons appris quelque chose de la pandémie de Covid-19, c'est que nous avons tous besoin les uns des autres pour survivre. (Vous n'êtes pas d'accord? Bien… Mais que ressentiriez-vous si le pays qui créait le premier vaccin efficace contre le coronavirus refusait de le donner à quiconque, en dehors de ses propres citoyens?)
Un concept en évolution
Selon les sages paroles du défunt Steve Jobs: «Vous ne pouvez relier les points en regardant vers l'avant, vous ne pouvez les relier qu'en regardant en arrière.» Cela me vient à l'esprit chaque fois que Simon parle de la première fois qu'il a utilisé l’expression «National Brand», dans une revue sur le marketing en 1998. Il ne se rendait pas compte – ni personne d’autre – que ces deux mots auraient un impact mondial durable et prendraient une vie propre. L'argument était simple: les pays qui ont une image positive (le Japon et la Suisse, par exemple) bénéficient de ce fait d’un avantage commercial, et ont plus de facilité à attirer les touristes, les investissements étrangers, les événements internationaux et les consommateurs pour leurs exportations.
Dans les années qui ont suivi, les gens qui vendaient des détergents et du shampooing se sont soudainement réinventés en tant que consultants en «image de marque nationale». Toute une industrie a été créée, englobant des conférences internationales, des publications et des prix annuels, dans le seul but d'enseigner aux représentants de gouvernements «l'art» de gagner les cœurs et les esprits.
Vous pouvez penser que Simon était fier de son article original et de son impact, mais si vous lisez The Good Country Equation ou que vous l'écoutez parler, vous aurez le sentiment qu'il le considère comme son péché originel!
Il vous dira que les termes qu'il a utilisé était «National Brand» et non «National Branding» – un concept auquel il s'oppose.
Les outils de marketing tels que la publicité, les relations publiques et la promotion des ventes ont leur place dans le positionnement des villes, en attirant des investissements étrangers ou en promouvant des destinations touristiques. Mais s’il s’agit d’un pays, Simon croit que les actions sont plus éloquentes que les mots.
«Se vanter de son propre pays, c'est comme un humoriste qui monte sur scène et dit au public à quel point il est drôle», écrit-il. «Ne leur dites pas de rire. Soyez amusant. Et de même, pour les pays, ne leur dites pas de vous admirer. Soyez admirable.»
Peu de temps après avoir défini les Nations Brands, Simon a créé un nouveau terme (et a également écrit un livre à ce sujet) appelé «Competitive Identity» ou, en français, «Identité compétitive». Comme vous pouvez le lire dans son nouvel ouvrage, le concept a évolué pour devenir celui d'un «bon pays». Le cœur et l'âme de ce nouvel argument est que ce dont le monde a besoin, c'est d'une coopération, et non d'une concurrence, entre les pays.
«Tous les gouvernements du XXIe siècle ont deux tâches : prendre soin de leurs citoyens et participer à une plus grande communauté de nations», soutient-il. Et si vous pensez que c'est irréalisable, l'auteur donne des exemples de la façon dont les pays qui veulent être «bons» peuvent trouver des moyens de combiner ces deux tâches et de jongler entre priorités et intérêts, bien que ce soit loin d'être simple.
Il existe plusieurs lectures possibles de ce livre.
La première consiste à y voir un recueil d'expériences personnelles et de souvenirs d'un conseiller vétéran de près de 50 gouvernements.
Une autre serait de le lire comme s'il s'agissait d'un manuel permettant aux fonctionnaires de réfléchir et d'apprendre des expériences d'autres pays, et éventuellement de mettre en œuvre ce que dit Simon.
Une troisième façon, peut-être la plus intéressante, est pour les lecteurs – qu'il s'agisse de spécialistes du marketing, d'universitaires ou de représentants du gouvernement – de remettre en question tout ce qu'ils pensent savoir sur les «Nation Brands» ou «marques nationales».
Et si vous acceptez ce défi, soyez prêt à être surpris d'apprendre que les dépenses en relations publiques pourraient aggraver votre problème d'image; que nous avons utilisé des mots à la mode, tels que «soft power», tous faux; et que contrairement à ce que beaucoup pensent, les événements sportifs mondiaux ne rendent pas nécessairement un pays plus désirable.
Faisal J. Abbas est rédacteur en chef d'Arab News
The Good Country Equation, de Simon Anholt, est publié par Berret-Koehler et est disponible dans les librairies en ligne et sur Amazon dans le monde entier.